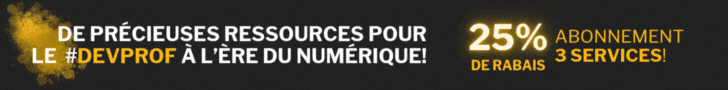De la mémoire à la réussite : stratégies gagnantes issues de la neuroéducation
Comment savoir si un élève a réellement compris une notion? Pourquoi certains semblent tout oublier après quelques jours? Comment éviter de les surcharger, soutenir leur attention ou mieux les outiller pour étudier? Lors d’une conférence présentée par l’Institut des troubles d’apprentissage, le chercheur en neurosciences Steve Masson a partagé des réponses éclairantes et, surtout, des pistes très concrètes pour aider les enseignants à améliorer la réussite de leurs élèves. Voici ce qu’il faut en retenir.