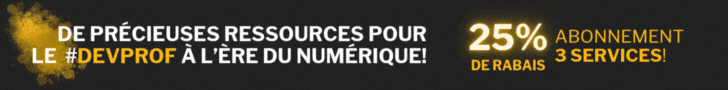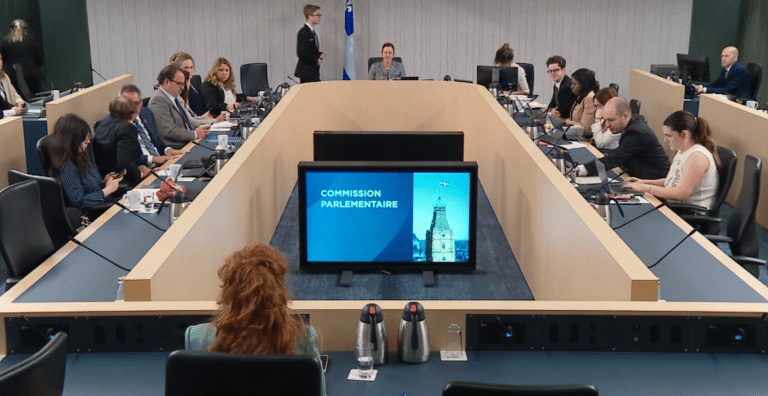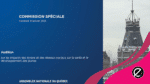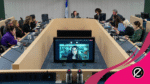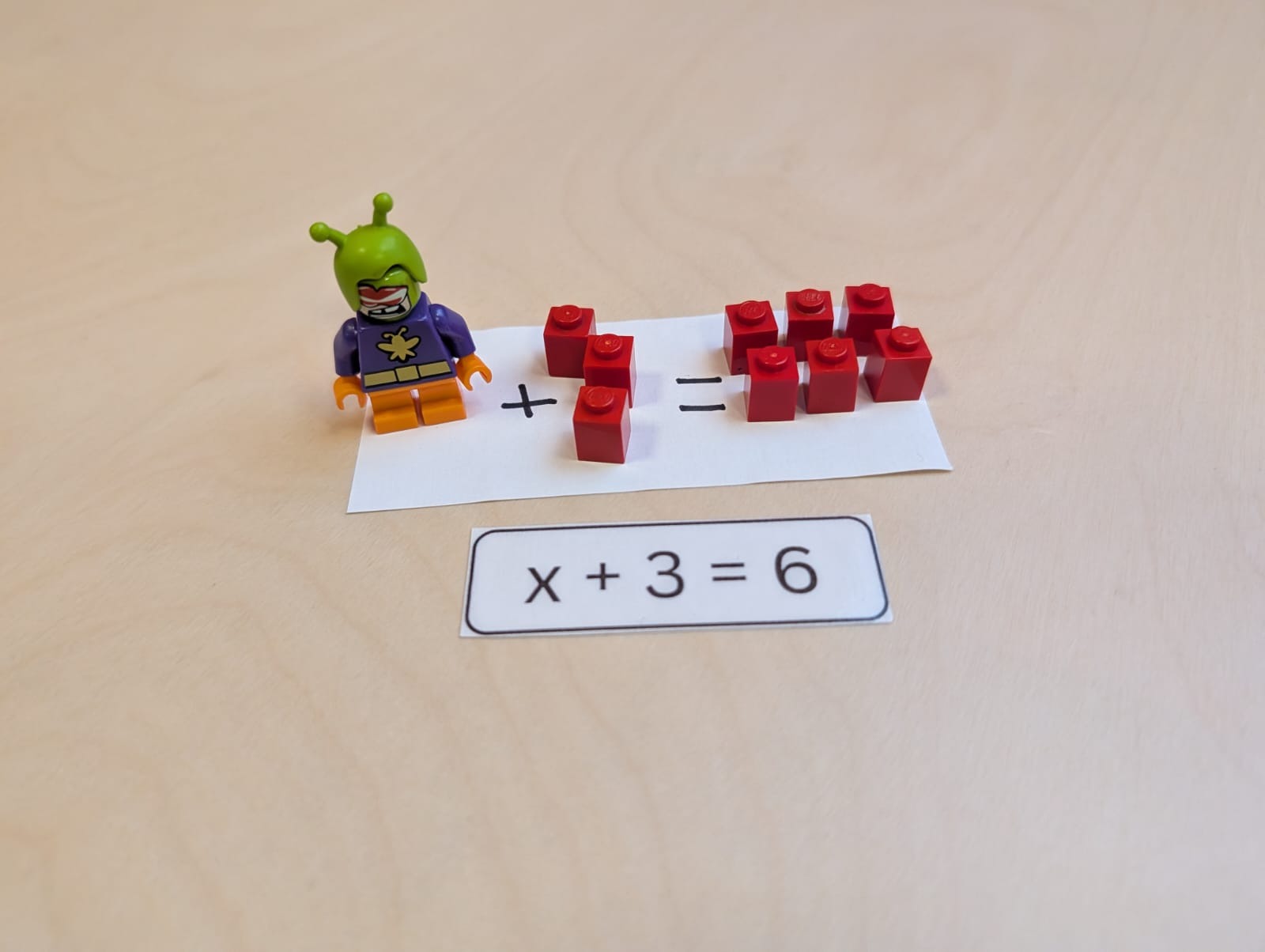Les travaux de la CSESJ, qui ont débuté le 12 septembre dernier, permettront aux députés membres d’entendre une quarantaine d’experts d’ici au 26 septembre. Ceux-ci proviennent de l’éducation, de la santé et des services sociaux, de la sécurité publique, du droit et du numérique.
L’Assemblée nationale du Québec a créé cette commission parlementaire le 6 juin 2024 pour étudier les enjeux liés, entre autres, au temps que les jeunes consacrent aux écrans, aux mesures d’encadrement de ces derniers, notamment à l’école et sur le Web et à la cyberintimidation, y compris le partage de matériel sexuellement explicite.
Les travaux se sont poursuivis la semaine dernière. Parmi les intervenants qui se sont présentés devant les députés membres, notons la Fédération des centres de services scolaires du Québec, la Fédération des établissements d’enseignement privés, la Fédération des syndicats de l’enseignement, le Centre canadien de protection de l’enfance ainsi que les Dre Magalie Dufour et Mélissa Généreux. Voici ce qui a retenu notre attention à ce moment.
À lire aussi : notre premier compte-rendu des travaux de la CSESJ.
Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)
De passage devant la Commission, la FCSSQ a prôné « une approche résolument éducative axée sur l’apprentissage et le développement d’un rapport plus sain des jeunes avec le numérique ». L’organisation a demandé la création d’une stratégie nationale qui inclurait le réseau scolaire ainsi que les adultes afin qu’ils puissent bien accompagner les jeunes dans leur cheminement.
« Pour bien encadrer la place du numérique à l’école, le Programme de formation de l’école québécoise, le Cadre de référence de la compétence numérique et la Politique d’évaluation des apprentissages doivent former un ensemble cohérent qui trace clairement la voie à suivre pour tous les intervenants. »
Au sujet de l’interdiction du cellulaire dans les écoles, la FCSSQ a dit préconiser « une approche éducative, dans la mesure où l’interdiction complète à l’échelle nationale n’amènera pas automatiquement des changements de comportements ».
« L’école constitue le lieu par excellence pour vivre une vie pleine et enrichissante, même avec son téléphone. »
Dans son mémoire, la FCSSQ a aussi demandé à ce que le nouvel Institut national d’excellence en éducation « proposer en continu des balises en matière d’utilisation du numérique en classe ».
Pour en savoir plus sur le point de vue de la FCSSQ, on peut consulter ici le mémoire déposé.
Fédération des établissements d’enseignement privé (FEEP)
Pour sa part, le président de la FEEP, David Bowles, a insisté sur la formation du personnel enseignant comme élément clé pour assurer une utilisation optimale des écrans à des fins pédagogiques et une éducation au numérique adéquate, et ce, tant en formation initiale qu’en développement professionnel. Il a indiqué que le modèle 1:1 (1 pour 1), où les appareils sont gérés par l’école, permet un contrôle accru. Cependant, cette façon de faire demande que l’ensemble des intervenants scolaires soit bien informés pour choisir et implanter les meilleures solutions.
« L’école a un rôle clé à jouer pour l’éducation au numérique. De plus, ces outils, lorsqu’ils sont utilisés de manière responsable et encadrée, peuvent favoriser l’apprentissage, l’interaction sociale et la créativité. Ils contribuent à la motivation de certains élèves en les amenant à être davantage engagés dans leurs apprentissages. Surtout, ils jouent un rôle clé pour amener à la réussite des élèves ayant des défis particuliers. »
Il est possible d’en apprendre plus sur le point de vue de la FEEP en consultant le mémoire déposé devant la Commission.
Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ)
De son côté, Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), s’est également montré d’accord avec une approche équilibrée concernant l’utilisation des écrans dans les établissements scolaires. « L’utilisation des écrans peut être très utile si elle repose sur une intention pédagogique, et qu’elle est mise au service des apprentissages. Il est donc essentiel que l’usage des technologies numériques soit réfléchi, et qu’il respecte les choix pédagogiques du personnel enseignant », a-t-il dit.
Tout comme M. Bowles, il a mentionné l’importance d’offrir des formations et des mesures d’accompagnement pour le personnel enseignant. « Avec toute l’information pertinente en main, les enseignants pourront faire les meilleurs choix pour leurs élèves et exercer pleinement leur jugement et leur autonomie professionnelle ».
Concernant l’utilisation du cellulaire à l’école, Karine Nantel, première vice-présidente de la FSE-CSQ, affirme que « l’accès à un téléphone personnel en classe est une source de distraction évidente, notamment en raison des enjeux liés à l’utilisation des réseaux sociaux. En revanche, une tablette ou un ordinateur fourni par l’école dans le cadre d’une activité d’enseignement est un outil intéressant qui permet de varier les approches pédagogiques et de stimuler les apprentissages ».
Pour en savoir plus sur le point de vue de la FSE-CSQ, on peut consulter le communiqué de presse diffusé.
Centre canadien de protection de l’enfance
Le Centre canadien de protection de l’enfance a souligné l’ampleur croissante de la sextorsion, avec en moyenne 10 signalements par jour depuis plus d’un an. La majorité du temps, ce sont des adolescents qui s’échangent des images et vidéos entre eux, signe qu’il n’y a pas assez de prévention en ce moment.
Selon René Morin, le porte-parole du Centre devant la Commission, les écoles sont généralement démunies face à ces situations et elles sont nombreuses à solliciter le Centre pour obtenir des conseils. Il appelle à revoir les politiques numériques et à inclure les problématiques actuelles dans les programmes scolaires.
Par ailleurs, l’utilisation de l’intelligence artificielle pour générer des images explicites d’enfants a également été mise en lumière par le Centre. Ces images, bien que fausses, provoquent des effets similaires aux images réelles. Le Centre dénonce la lenteur de certaines plateformes à supprimer ces contenus et demande des mesures législatives, notamment une vérification d’âge pour accéder à ces sites. Il appelle aussi à l’adoption de technologies de filtrage dans les écoles pour mieux protéger les jeunes, tout en préconisant une approche éducative et préventive, plutôt que punitive.
Dre Magali Dufour, psychologue et professeure agrégée, Université du Québec à Montréal
Magali Dufour, psychologue et professeure à l’UQAM, spécialiste des dépendances, a mis en lumière l’augmentation des problèmes de dépendance aux écrans chez les adolescents. En 2012, 20 % des jeunes montraient des signes de difficultés, avec 1 % nécessitant un traitement. En 2018, ce chiffre est monté à 30 %, dont 3,3 % en traitement, un taux aligné sur la moyenne mondiale. C’est la dépendance aux jeux vidéos qui est loin devant celle aux réseaux sociaux ou au « streaming ».
De plus, les jeunes impliqués dans l’eSport seraient plus à risque, passant parfois plus de 50 heures par semaine sur des jeux vidéo. Ne souhaitant pas faire interdire ces pratiques dans les écoles, Magali Dufour plaide plutôt pour des programmes parascolaires encadrés, soulignant les bienfaits potentiels pour la socialisation des jeunes ayant une faible estime de soi qui retrouve un environnement stimulant pour eux.
Selon elle, il est nécessaire de trouver un équilibre et d’offrir plus de soutien aux jeunes et à leurs parents. « Les jeunes eux-mêmes sont conscients des risques et veulent être impliqués dans la gestion de leur usage des écrans », a-t-elle soutenu à plusieurs reprises.
Elle appelle néanmoins à l’interdiction des microtransactions et des pratiques de renforcement continu dans les jeux, qui stimulent l’obsession. Elle souligne le manque de programmes d’intervention pour les jeunes à risque et insiste sur la nécessité d’impliquer l’industrie des jeux vidéo dans le développement d’outils de sensibilisation et de prise de décision éclairée pour les jeunes et leurs parents, en s’inspirant de ce qui a été fait dans l’industrie des jeux de hasard et d’argent.
Dre Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et professeure titulaire, Université de Sherbrooke
Dre Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique, a souligné les impacts à la fois positifs et négatifs des écrans sur les jeunes. Parmi les effets positifs, elle cite les relations amicales et amoureuses que les jeunes entretiennent via les plateformes. Cependant, une trop grande utilisation peut conduire à des problèmes de sommeil, en plus de nuire à la réussite éducative et la qualité de l’environnement familial.
Bien que l’usage excessif des écrans soit lié à des symptômes dépressifs et anxieux, la Dre Généreux souligne l’absence d’études approfondies sur les liens causaux. Des études seraient nécessaires à ce sujet. D’autres intervenants devant la commission ont aussi mentionné le peu de connaissance scientifique à ce sujet.
Finalement, elle a comparé l’enjeu des écrans aux grandes luttes en santé publique, comme le tabac et la malbouffe, en raison de leur caractère addictif. Elle recommande néanmoins une approche plus nuancée, axée sur la réduction des impacts négatifs et des inégalités sociales, tout en évitant l’interdiction. Un guide pratique pour aider les écoles à gérer l’usage des écrans serait nécessaire.
À lire aussi : notre premier compte-rendu des travaux de la CSESJ avec les points de vue de :
- la Fédération des comités de parents du Québec
- l’Association Edteq
- le Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne (CIEL)
- le député de Vanier-Les Rivières, Mario Asselin
Pour suivre les travaux de la Commission
Accédez à la webdiffusion en direct sur le site de l’Assemblée nationale du Québec.
Consultez la liste des organisations qui témoigneront ainsi que l’horaire sur cette autre page.
Dernières plages-horaire de la Commission :
- 24 septembre 2024 9 h 45 à 12 h 10 et 16 h à 19 h 20
- 26 septembre 2024 11 h 15 à 19 h 15
Il est également possible de visionner les séances passées sur le site.
À lire aussi :

29 mai 2025
Communiqué – La Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ) a déposé aujourd’hui son rapport final. Dans ce rapport disponible en ligne, la Commission émet 56 recommandations, dont celle interdisant les appareils mobiles personnels dans les écoles primaires et secondaires du Québec, annoncée le 22 avril dernier dans un rapport intérimaire.

23 avril 2025
Communiqué - La Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes a déposé un rapport intérimaire portant sur l’usage des appareils mobiles personnels dans les écoles primaires et secondaires du Québec.

18 février 2025
La Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ) a conclu sa deuxième phase d’auditions publiques à Québec. Des experts ont tiré la sonnette d’alarme : sextage, exploitation et cyberintimidation se multiplient, touchant des victimes de plus en plus jeunes. Si les bienfaits de l’utilisation des technologies pour l’apprentissage ont continué d’être prônés pendant ces journées, l’urgence d’une meilleure littératie numérique de l’école à la famille s’est imposée comme une priorité.

18 février 2025
Lors de leur intervention devant la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ), Sandrine Faust et Marc-Antoine Tanguay, du service d’accompagnement scolaire Alloprof, ont mis en lumière le rôle positif que peuvent jouer les outils numériques dans l’apprentissage, tout en insistant sur l’importance d’un encadrement adéquat.
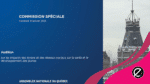
4 février 2025
La Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ) du Québec a amorcé sa deuxième phase de consultations particulières et d’auditions publiques. La deuxième journée a vu défiler plusieurs spécialistes des technologies éducatives qui sont venus témoigner de l’importance d’éduquer les jeunes à l’usage des technologies et de l’impact positif que les milieux scolaires peuvent avoir sur eux.
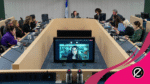
3 février 2025
La Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ) du Québec a amorcé sa deuxième phase de consultations particulières et d’auditions publiques. Pendant la première journée, la santé des enfants et l’influence parentale ont été au cœur des discussions.

8 novembre 2024
Certains des membres de la Commission parlementaire spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ) étaient en tournée dans des écoles de l’Est du Québec cette semaine. Nous avons discuté avec la présidente de la CSESJ, Amélie Dionne, pour faire le bilan.

23 septembre 2024
Les travaux se sont poursuivis à la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ) la semaine dernière. Voici ce qui a retenu notre attention dans les présentations de la Fédération des centres de services scolaires du Québec, la Fédération des établissements d’enseignement privés, la Fédération des syndicats de l’enseignement, le Centre canadien de protection de l’enfance ainsi que les Dre Magalie Dufour et Mélissa Généreux.

16 septembre 2024
Premiers de nombreux intervenants et groupes attendus, la Fédération des comités de parents du Québec, l’Association Edteq et le Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne (CIEL) ont témoigné jeudi dernier devant la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes, qui débutait à Québec.