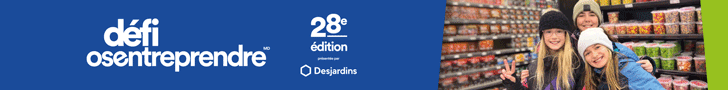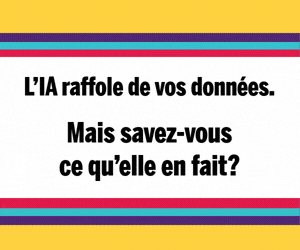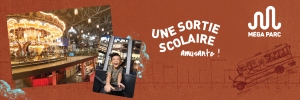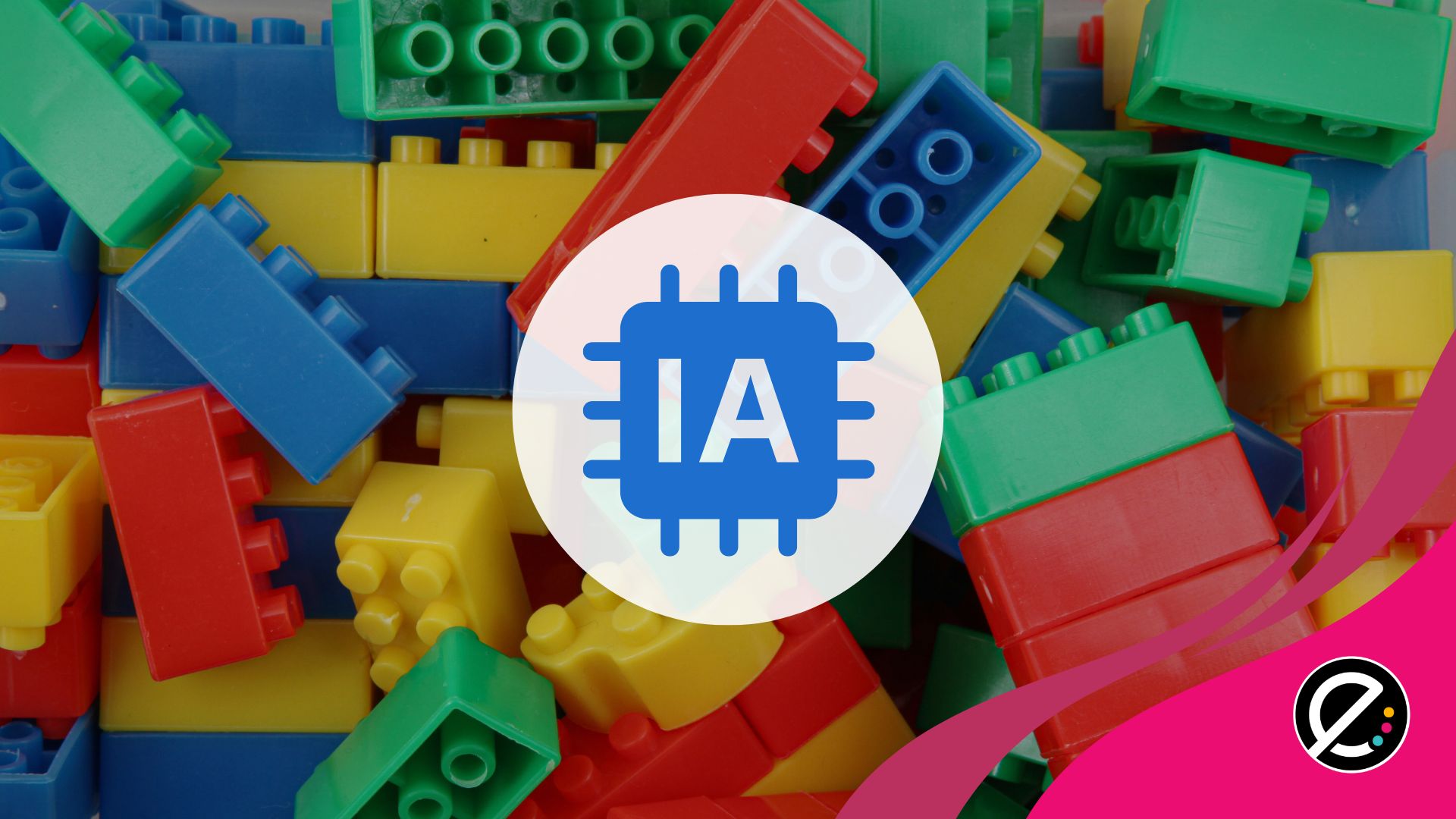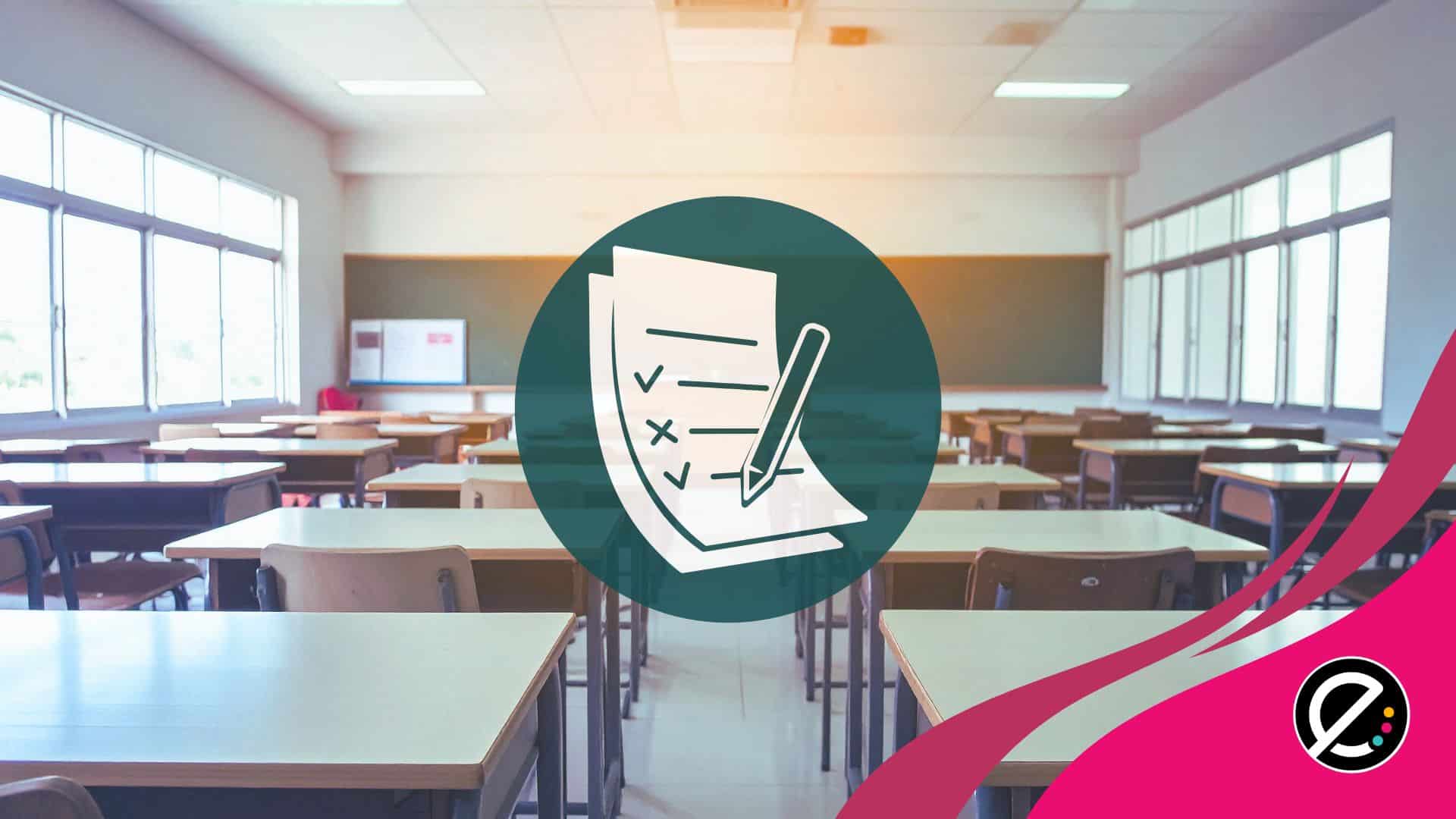Par Alex Baudet, Université Laval et Marie-Agnes Parmentier, HEC Montréal
Depuis septembre, les élèves du primaire et du secondaire à travers le Québec doivent s’adapter à une nouvelle règle importante : l’interdiction complète du cellulaire à l’école. Ce débat, bien qu’il domine les conversations entourant la rentrée scolaire, n’est pas nouveau, ni spécifique au Québec.
Les inquiétudes des parents vis-à-vis de l’utilisation des technologies par leurs enfants ne cessent de grandir, alimentées notamment par les histoires de suicides d’ados après des échanges avec ChatGPT ou encore les accusations d’exploitation d’enfants sur Roblox. Les gouvernements, un peu partout dans le monde, réagissent à ces craintes concernant l’impact des technologies numériques sur les jeunes en mettant en place des interdictions.
En tant que chercheurs des usages numériques au quotidien, nous soutenons qu’une interdiction, à elle seule, passe à côté d’un enjeu crucial pour les familles. Car une fois de retour à la maison, ce sont les parents qui se retrouvent à gérer seuls l’usage des écrans. Et puisque la majorité des activités en ligne échappent à leur regard, établir des règles claires — et maintenir un dialogue ouvert — devient un véritable défi.
Le besoin de littératie numérique pour les parents
Selon l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique, un organisme de recherche français, 53 % des parents estiment manquer de soutien en matière d’éducation numérique de leurs enfants.
Notre recherche démontre que le problème ne se limite pas au temps d’écran. C’est aussi l’invisibilité des activités des jeunes qui alimente les tensions à la maison.
Par exemple, un adolescent que nous avons interviewé utilisait les jeux vidéo pour rester en contact avec ses amis. Sa mère, elle, y voyait une manière de s’isoler. Une discussion aurait pu apaiser la situation, mais le stigma entourant le jeu vidéo a compliqué les choses.
Ces différences de perception creusent encore plus le fossé numérique entre les parents et leurs enfants.
Penser au-delà du temps d’écran
Le temps passé devant un écran, en soi, ne dit pas grand-chose sur ce que les jeunes font réellement en ligne. Certaines études montrent qu’un usage modéré — environ une heure par jour — est lié à un taux plus bas de dépression, et que les plateformes numériques peuvent même favoriser des amitiés plus diverses et inclusives que dans la « vraie vie ». Bref, tout est dans le contexte : ce que les jeunes font, avec qui et dans quelles conditions.
Dans notre recherche, c’est à travers le contexte des jeux vidéo, que nous avons cherché à mieux comprendre comment les familles vivent la technologie à la maison.
Nous avons constaté que les inquiétudes parentales ne portent pas seulement sur le jeu lui-même — souvent vu comme isolant ou improductif — mais aussi sur la façon dont il bouscule les routines familiales. Un exemple probant serait celui d’un enfant qui refuse de quitter sa partie pour venir souper. Comme ces technologies sont conçues pour capter et retenir l’attention, leur effet sur la dynamique familiale est trop souvent ignoré.
Le défi de l’invisibilité
Ces tensions sont amplifiées par la partie invisible des activités en ligne. Voir un jeune devant un écran ne raconte pas toute l’histoire : est-il en train de socialiser avec ses amis, d’argumenter avec des inconnus ou de faire face à des propos nocifs ?
Cette opacité complique sérieusement les négociations à l’intérieur des foyers. Bien que les parents imposent des règles — « une heure de jeu », « pas de cellulaire après 21 h » — ces limites peuvent paraître arbitraires et injustes aux yeux des ados, si elles sont mises en place sans comprendre les dynamiques propres au numérique.
Dans notre étude, plusieurs jeunes décrivaient le même dilemme. D’un côté, quitter une partie en plein milieu signifiait s’exposer à des pénalités — souvent sous la forme d’un ban temporaire — et laisser tomber leurs coéquipiers. D’un autre, rester en ligne les mettait en porte-à-faux avec les attentes familiales, comme venir souper. Résultat : les parents se sentent défiés, les enfants incompris.
Pourquoi les interdictions ne suffisent pas
Au niveau des politiques publiques, interdire les appareils en classe peut réduire les distractions. Mais cela aide peu les familles à encadrer l’usage des écrans à la maison, où les tensions réapparaissent rapidement.
L’expérience internationale montre d’ailleurs que ces interdictions ne règlent pas les problèmes de fond.
En Australie, par exemple, où plusieurs États restreignent l’usage du cellulaire à l’école, des chercheurs rappellent que ces mesures ne devraient pas remplacer des efforts plus larges en littératie numérique.
Miser sur la littératie et le dialogue
Si nous voulons vraiment soutenir les familles, il faut mieux comprendre ce qui se passe derrière l’écran. Cela signifie aider les parents à poser les bonnes questions, à saisir le contexte d’utilisation et à négocier des règles justes.
Les téléphones et les consoles sont souvent perçus comme des objets « personnels », ce qui laisse les parents à l’écart de ce qui s’y passe réellement. Le dialogue est essentiel, mais il doit être soutenu par des ressources adaptées.
Au Québec, par exemple, Vidéotron s’est associé au CIEL pour offrir des outils qui aident les familles à discuter et à mieux encadrer l’usage du téléphone.
Dans notre recherche auprès de joueurs compétitifs, nous avons vu que ce type d’initiatives illustre bien le rôle que peuvent jouer les intermédiaires : agir comme des coachs, capables d’accompagner jeunes et parents vers des pratiques numériques plus saines et équilibrées. Plutôt que de laisser les familles se débrouiller seules, ou de miser uniquement sur les interdictions à l’école, ces soutiens structurés rendent plus tangible ce qui reste souvent invisible derrière l’écran.
Il faut aussi rappeler que l’usage du numérique est rarement solitaire. Un enfant qui joue est connecté à ses amis. Un ado qui scroll sur les réseaux sociaux navigue à travers des pressions sociales bien réelles.
Reconnaître ces liens permet aux parents de dépasser la logique des simples limites de temps d’écran pour aborder des questions plus profondes : la sécurité, l’équilibre, le bien-être.
Nos recherches montrent que lorsque les familles réussissent à parler ouvertement de la réalité en ligne, même si les parents ne comprennent pas tous les détails des plates-formes, les tensions diminuent. Les règles deviennent alors plus faciles à accepter et à respecter.
Et après ?
La technologie évoluera toujours plus vite que les politiques publiques. Les interdictions peuvent offrir un répit temporaire, mais elles ne remplacent pas le dialogue, la littératie numérique et la patience des familles au quotidien.
En ce début d’année scolaire, la véritable question n’est pas seulement de savoir si les cellulaires ont leur place en classe, mais plutôt de trouver des moyens concrets d’appuyer les familles dans un univers numérique où une grande partie de la réalité reste invisible.
Par Alex Baudet, Assistant professor in Marketing, Université Laval et Marie-Agnes Parmentier, Professor of Marketing, HEC Montréal
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.