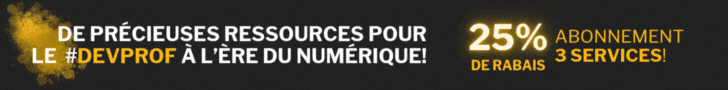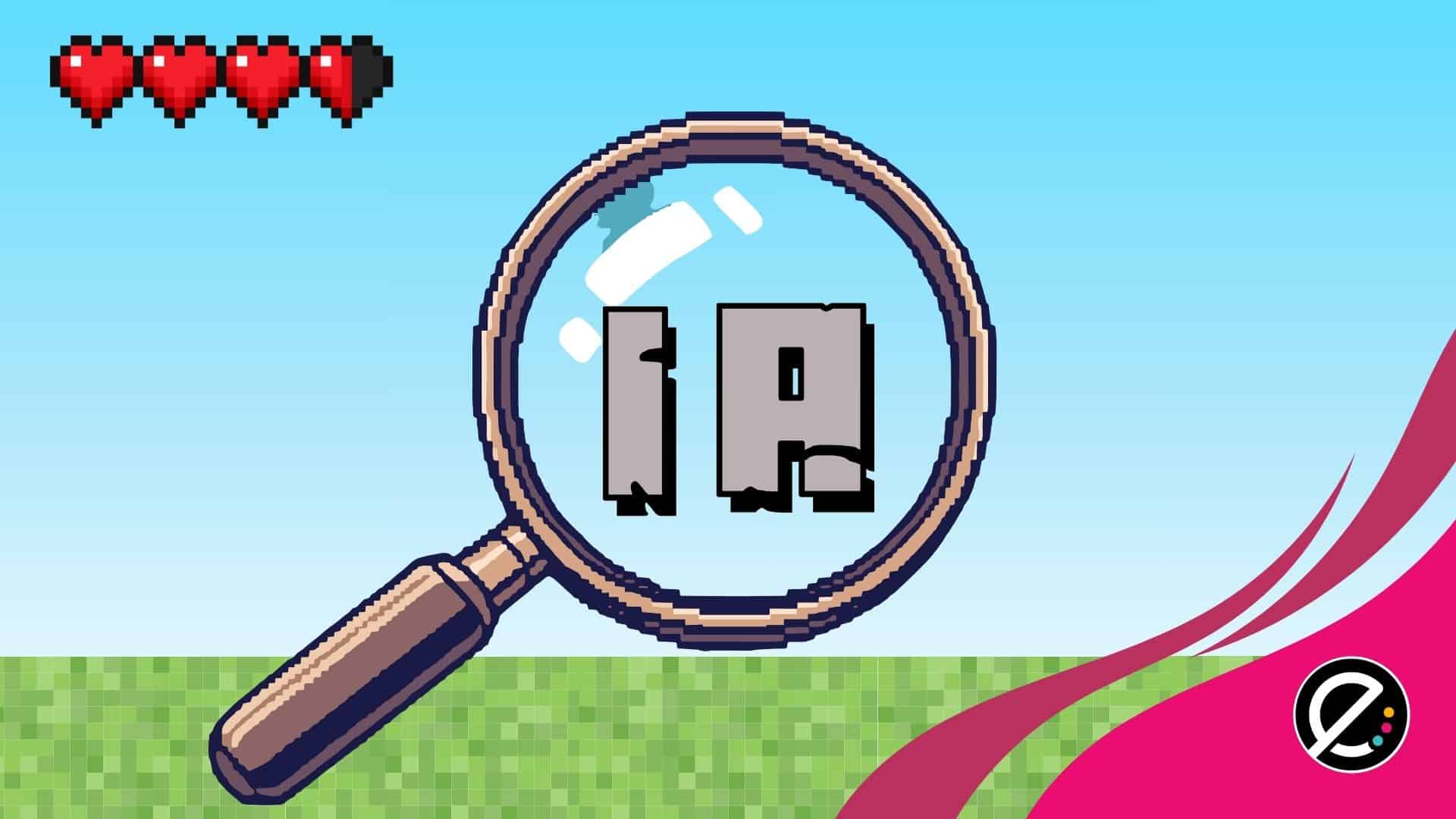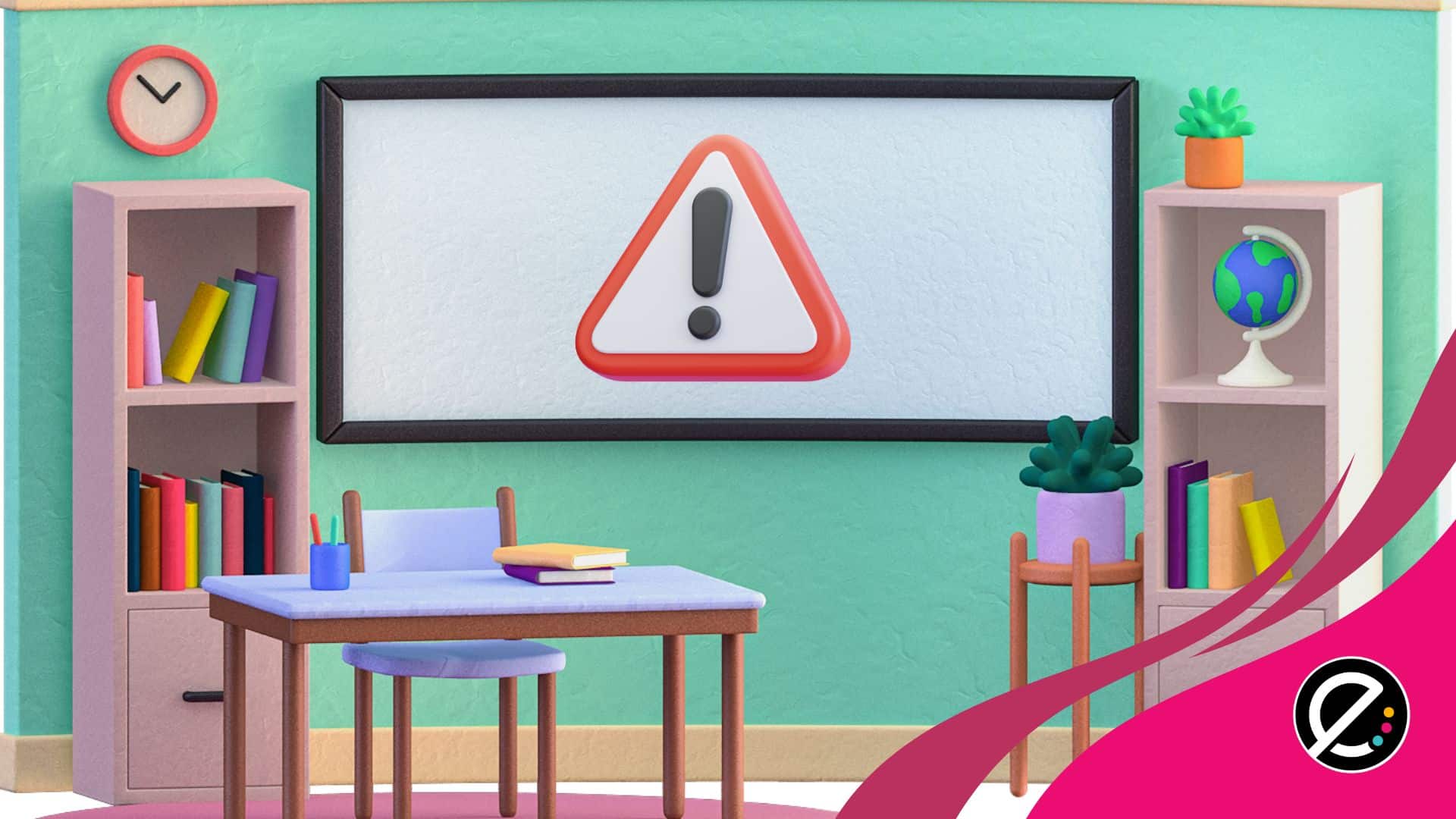Loin de se réduire à une seule définition, le jeu vidéo en contexte scolaire englobe une diversité d’usages. Pour Steve Quirion, du Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social, le jeu constitue avant tout un outil d’apprentissage et de création. Des plateformes telles que Minecraft Éducation, Make Code et Scratch sont d’ailleurs utilisées en milieu scolaire pour programmer et concevoir des jeux.
D’autres intervenants, comme Philippe Gauthier de l’Académie Esport de Québec, soulignent l’importance de distinguer les usages pédagogiques des usages compétitifs. « Ce n’est pas parce qu’on utilise des jeux vidéo en classe que c’est du sport électronique », précise-t-il. Pour que l’esport soit reconnu comme tel, une structure compétitive est nécessaire, impliquant des affrontements entre équipes ou joueurs, généralement dans un cadre parascolaire. Selon lui, une dizaine de jeux seulement se prêtent véritablement à ce type d’activité.
Des projets pédagogiques ancrés dans le programme
Pour plusieurs enseignants présents au panel, le jeu vidéo devient un vecteur d’apprentissage puissant, à condition d’être bien encadré. Guillaume Prairie, enseignant de 5e année au Centre de services scolaire des Navigateurs, utilise Minecraft Éducation pour enseigner le français : « Tu as deux prédicats, tu as deux blocs rouges », illustre-t-il en parlant d’analyse syntaxique qui devient plus graphique dans l’univers du jeu. Il évoque aussi la création de labyrinthes d’homophones et de mondes dont les élèves sont les héros.
De son côté, Stéphanie Rioux, du Service national du RÉCIT, domaine de la mathématique, de la science et de la technologie, développe également des tâches mathématiques et scientifiques dans Minecraft Éducation. Par exemple, elle a déjà proposé à des élèves de construire des bassins olympiques ou des terrains de football américain pour explorer des concepts comme les surfaces, les volumes et le raisonnement mathématique. Elle insiste : « Le plaisir d’apprendre est essentiel, mais il faut encadrer les activités et garder une intention pédagogique claire. »
Préparer, encadrer, réfléchir
Tous s’accordent sur un point : l’intégration du jeu vidéo à l’école ne peut se faire à la légère. Selon Steve Quirion, il faut penser les activités en trois temps — avant, pendant, après — afin de guider les élèves dans leurs apprentissages. « Quand ils sont dans le jeu, ils perdent souvent le fil de l’intention d’apprentissage. Il faut les aider à désapprendre leur réflexe de joueurs », explique-t-il. Le rôle de l’enseignant devient alors celui d’un médiateur, qui aide à faire le pont entre l’univers du jeu et les objectifs scolaires. Il doit donc être bien préparé avant chaque activité. De même, après chaque activité, il est important de revenir sur les notions apprises pour valider que les objectifs ont été atteints.
Philippe Gauthier rappelle également que chaque jeu mobilise des compétences spécifiques, ce qui implique que le choix du jeu devrait être guidé par les aptitudes à développer. Il insiste sur l’importance de la phase de préparation avant même d’entrer dans le jeu avec les jeunes. Dans un contexte de jeux électroniques, il est essentiel d’apprendre à décoder les mécaniques propres à chaque jeu, à élaborer des stratégies adaptées et à renforcer la communication en équipe. Selon lui, « l’esprit sportif, c’est aussi savoir transmettre la bonne information au bon moment ».
Combattre les stéréotypes, créer de nouvelles avenues
Le panel a également permis de déconstruire plusieurs idées reçues. Non, les jeux vidéo ne sont pas réservés aux garçons. Non, les élèves ne passent pas plus de temps devant les écrans lorsque le jeu est intégré au contexte scolaire. Et non, les joueurs ne sont pas asociaux, ni ne le deviennent du fait de leur pratique.
« Parfois, le sport électronique permet de faire briller des jeunes qui sont invisibles dans les autres sphères scolaires », note Philippe Gauthier. « Dans ma classe, on ne joue pas, on travaille sur Minecraft », ajoute Guillaume Prairie.
Néanmoins, tous s’accordent sur l’importance d’accompagner les enseignants dans l’intégration de cette pratique. Leur principal conseil? Choisir un outil que l’on apprécie, s’entourer de collègues, impliquer les élèves et valider la valeur pédagogique des activités retenues. Et surtout, documenter les expériences afin d’inspirer d’autres milieux, tout en s’appuyant sur ce qui a déjà été réalisé ailleurs avant de lancer un nouveau projet.
En complément :