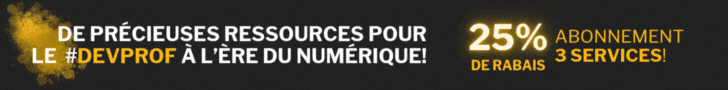Tous les enseignants vous le diront, la satisfaction de voir qu’un élève a compris et le sentiment d’avoir fait une différence auprès des jeunes de sa classe est un sentiment qui énergise et gratifie. C’est ce qu’on appelle de la satisfaction par compassion, responsable du bien-être ressenti par exemple quand on voit ses proches heureux du cadeau qu’on leur a fait, ou de l’aide qu’on leur a apporté.
À l’opposé, accompagner quelqu’un dans des situations difficiles, que ce soit en le soutenant, l’écoutant, l’accompagnant dans sa recherche de solution ou simplement en étant témoin de ses difficultés, peut engendrer de la fatigue par compassion. La fatigue par compassion, souvent appelée le traumatisme vicariant, est une absorption de la détresse de l’autre où l’intervenant ressent lui-même cette fatigue. Celle-ci est bien connue chez les intervenants de première ligne (policiers, infirmières, pompiers, psychologues et thérapeutes, et même chez les vétérinaires).
Le traumatisme vicariant est cependant moins connu chez les enseignants, bien que la reconnaissance gagne du terrain. L’enseignement est une profession qui requiert beaucoup d’empathie et un lien de confiance significatif avec les élèves. Il n’est pas étonnant que les enseignants, par leur proximité, accessibilité et lien de confiance, soient souvent les premiers à qui se confient les élèves (en classe ou en ligne) en cas de problème.
Avec la pandémie, les temps sont plus difficiles pour tous. Les élèves sont plus nombreux à vivre des situations de violence conjugale, de consommation de drogue ou alcool, à côtoyer des personnes qui souffrent de troubles de santé mentale (et en souffrir eux-mêmes) et des situations où les parents ont de la difficulté à garder leur calme avec eux. L’augmentation de ces difficultés se transforme en une augmentation de la détresse rapportée aux enseignants.
Il faut se réjouir de ces élèves qui vont chercher de l’aide, du soutien et des services en se référant à un enseignant. Comme on ne peut pas, et on ne veut pas, réduire le nombre d’élèves qui se confient, Astrid Kendrick (Ph.D Éducation), dans un article de The Conversation, propose d’implanter des solutions pour aider les enseignants dans cette situation afin d’éviter qu’un traumatisme vicariant se transforme en épuisement professionnel.
À cet effet, elle fait les quatre recommandations suivantes :
- La culture de l’école. On sait tous combien un environnement de travail négatif peut avoir des impacts sur le moral. Par conséquent, un environnement de travail positif, le fait d’avoir des collègues empathiques, du temps pendant la journée de travail pour prendre soin de soi, un leadership positif et aidant de la direction, sont tous des éléments bénéfiques.
- Le support de la communauté. La fermeture des écoles en mars 2020 a mis en évidence que la société a besoin des enseignants. Cette relation est bidirectionnelle et les enseignants ont tout autant besoin de la société. La reconnaissance du travail des enseignants est significative dans un processus de guérison. Cette reconnaissance se vit à plusieurs niveaux; tous peuvent contribuer à surmonter la fatigue de compassion. Par exemple, les parents qui prennent quelques minutes de leur journée chargée pour remercier l’enseignant font une grande différence! Les implications communautaires sont aussi significatives. Chaque mesure qui vise à réduire les difficultés, traumatismes, violence et négligences vécus par les élèves est aussi une mesure qui aide les enseignants à faire leur travail dans de meilleures conditions.
- Prendre soin de soi. Adopter de saines habitudes de vie, faire des activités avec les enfants, se connecter avec la nature, sont des moyens de prendre soin de soi.
- Un support professionnel. Le traumatisme vicariant est bien réel et doit être considéré avec sérieux et professionnalisme au même titre qu’un autre problème de santé mentale. Les professionnels (psychologues, médecins ou psychiatre) ont des compétences pour aider en cas de besoin. Le soutien de la part des supérieurs et des collègues est aussi important. La majorité des centres de services scolaires offrent des programmes d’aide aux employés. Ces programmes permettent de consulter un professionnel rapidement et en toute confidentialité.
C’est en s’entraidant et en s’occupant de soi et de ses collègues, comme on le fait déjà pour les élèves, qu’on pourra faire une différence auprès de son entourage.
Pour aller plus loin, on peut retrouver des ressources gouvernementales ici. Aussi, Info-Santé 811 offre un service de consultation gratuit et confidentiel, offert 24/7 (même lors des jours fériés).