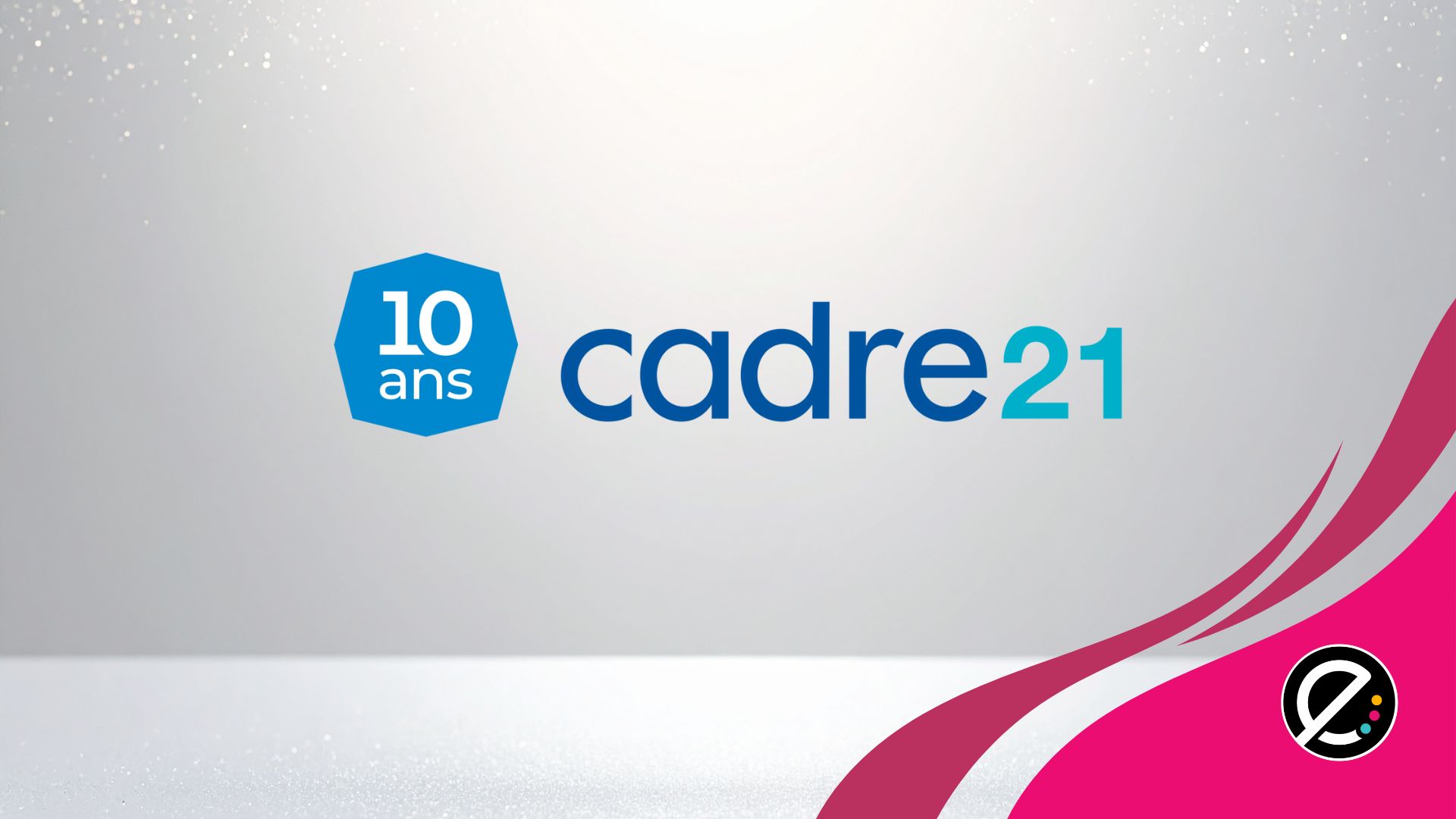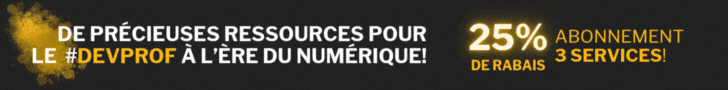Par Charles-Antoine Bachand, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Considérant l’ampleur des crises socioenvironnementales qui caractérisent l’anthropocène, de plus en plus de chercheurs estiment que les petits gestes écologiques ne suffiront pas et qu’il est urgent de plutôt miser sur des actions collectives. Pourtant, les systèmes scolaires peinent à faire une place à de telles actions dans leurs programmes de formation.
Professeur en fondements de l’éducation, c’est notamment à ce type d’enjeux que je m’intéresse. Que devrait enseigner l’école ? Comment peut-on permettre à l’école de réellement jouer son rôle social et démocratique ? Comment l’école peut-elle contribuer au pouvoir d’action des enfants et des citoyens ?
Dans cet article, je m’intéresse au concept de capabilités politiques collectives et illustre pourquoi celles-ci pourraient contribuer à repenser l’éducation en anthropocène.
L’anthropocène, un problème politique
D’abord, notons que l’anthropocène est une expression de plus en plus utilisée pour identifier l’époque actuelle, alors que l’espèce humaine et les conséquences de ses actions se comparent à celles d’autres forces géologiques (volcans, mouvements tectoniques, etc.).
Or, contrairement aux autres forces géologiques, on peut espérer que l’humanité agit de façon délibérée et réfléchie. L’anthropocène n’est en ce sens pas simplement une époque de crises environnementales, mais bien plus un problème politique et collectif découlant des valeurs et des caractéristiques politiques, économiques et sociales de nos sociétés.
À ce sujet, plusieurs chercheurs ont souligné l’ambiguïté du concept d’anthropocène, qui tend à mettre tous les êtres humains dans le même panier et à leur attribuer la même responsabilité concernant les crises actuelles. Le terme Capitalocène est ainsi parfois proposé pour désigner plus précisément la responsabilité historique de la colonisation, du capitalisme et de l’exploitation du Sud par le Nord dans la naissance de cette nouvelle époque.
Pour notre part, comme le géologue catalan Carles Soriano, nous continuons de privilégier le terme anthropocène, tout en reconnaissant le bien-fondé des critiques apportées par ces collègues. À ce titre, Soriano précise que si la nouvelle époque dans laquelle nous nous trouvons est bien l’anthropocène, le premier âge de l’anthropocène pourrait être nommé le Capitalian afin de reconnaitre le rôle du capitalisme dans son apparition.
Pourquoi l’éducation doit-elle changer ?
Pourquoi, dès lors, repenser l’éducation ? Parce que l’anthropocène est d’abord social : l’action humaine l’a provoqué et doit donc être mobilisée pour en freiner les dégâts et en attaquer les causes (GES, érosion de la biodiversité, etc.). Il amplifie en outre les injustices et les souffrances humaines (zoonoses, inondations, sècheresses, migrations) et menace même l’habitabilité de la Terre.
En ce sens, former de simples « citoyens résilients » ou « éco-responsables » semble dérisoire. Les injustices qui nourrissent les crises environnementales – et que celles-ci accentuent – exigent un véritable pouvoir d’agir : la capacité, à la fois individuelle, collective et politique, de contester les structures injustes et de formuler des alternatives solidaires et durables.
Or, malgré une prise de conscience croissante, l’école reste marquée par une logique néolibérale où l’environnement est souvent réduit à une ressource. Les programmes abordent les crises environnementales sous un angle individualiste et apolitique, comme si l’on pouvait les contempler hors du monde qu’elle bouleverse. Ce traitement évoque à peine les répercussions sociales, et limite l’action à de simples gestes personnels, alors que les intérêts économiques dominent. De quoi, ajouter à l’écoanxiété des jeunes jugeant bien l’ampleur du porte-à-faux entre les actions proposées et la tâche à accomplir.
Ce traitement est problématique : il occulte les causes structurelles des crises, rend invisibles les luttes des populations touchées et affaiblit les ressorts critiques de la citoyenneté démocratique nécessaires pour imaginer d’autres modes d’organisation sociale. C’est pourquoi, dans mes travaux, j’examine les potentialités de la capabilité politique collective (CPC) formulée par la chercheuse ontarienne Monique Deveaux. Issue des mouvements populaires, cette notion pourrait renouveler l’approche de l’action collective et de l’apprentissage démocratique en éducation.
Capabilités politiques collectives : un cadre pour l’éducation transformatrice
Le concept de capabilité est issu des travaux de l’économiste et philosophe indien Amartya Sen et de la philosophe états-unienne, spécialiste de philosophie morale et politique, Martha Nussbaum.
Très schématiquement, par ce concept, Sen rappelle que les libertés ne se mesurent pas aux seuls textes juridiques : elles dépendent des conditions concrètes qui permettent de les exercer. Le droit à l’éducation, par exemple, demeure théorique si l’école est inaccessible, coûteuse ou discriminatoire : l’enfant possède le droit, non la capabilité d’apprendre. La perspective des capabilités souligne donc qu’il ne suffit pas de proclamer un droit… encore faut-il instaurer les conditions matérielles, symboliques et institutionnelles qui rendent son exercice réellement possible pour toutes et tous.
Dans le cadre de ses travaux, Deveaux reprend ce concept en lui ajoutant une dimension collective et solidaire. Elle définit la capabilité politique collective (CPC) comme l’aptitude d’un groupe à se constituer en sujet politique capable de fixer des objectifs communs et de les poursuivre efficacement. Cette aptitude englobe des compétences adaptées au contexte qui n’existent qu’à l’échelle du collectif : élaborer des stratégies concertées, négocier, délibérer et décider ensemble, mais aussi créer de nouvelles structures adaptées aux besoins réels de la communauté.
Les CPC rendent ainsi possibles des réalisations (changer une loi, fonder une coopérative, mobiliser contre une injustice, etc.) qu’aucun individu ne pourrait atteindre seul. À ce titre, Deveaux identifie deux grandes familles de CPC : les compétences pour l’action revendicatrice (organisation, négociation, mobilisation) et les compétences de coopération et d’imagination (mutuelles, coopératives de travail).
Articuler pédagogie et transformation socioécologique
Alors que l’un des problèmes que pose l’anthropocène est justement l’action collective, ce qu’elle implique et comment il est possible de la développer, les CPC semblent offrir un cadre pour réfléchir ce que l’action collective exige.
Ainsi, une éducation en anthropocène fondée sur les CPC pourrait viser à développer chez les jeunes des capacités à s’organiser collectivement, à analyser les rapports de domination, à agir politiquement et à concevoir des alternatives viables à l’intérieur comme à l’extérieur des cadres institutionnels dominants.
Les jeunes auraient ainsi les outils nécessaires pour modifier leur monde, même lorsque les outils démocratiques, présents en théorie, ne sont pas disponibles (accès à la justice, à une représentation politique impartiale, etc.). Cela impliquerait néanmoins de ne plus mettre un accent aussi marqué sur le mérite individuel des élèves, mais sur leurs réussites collectives.
L’éducation deviendrait alors un levier pour renforcer le pouvoir d’agir collectif et pourrait dès lors réellement contribuer à une transition socioécologique juste.
Une éducation pour refonder le bien commun planétaire
Préparer la jeunesse à l’anthropocène, c’est l’armer pour l’incertitude, la conflictualité et la cocréation d’un monde habitable. Loin d’une injonction à l’adaptation technicienne, l’éducation doit devenir un espace critique d’invention collective. Les élèves‑citoyens doivent pouvoir agir ensemble pour la justice sociale et environnementale, interroger les normes dominantes et en élaborer de nouvelles.
Cette ambition rejoint l’appel de l’UNESCO à une « éducation transformatrice » et fait écho à l’une des préoccupations qu’avait un petit groupe de chercheurs auquel j’ai contribué lors de l’élaboration de son projet de compétence enseignante en lien avec le développement de l’agir écocitoyen chez les élèves.
Le cadre des capabilités politiques collectives offre ainsi un levier théorique et pratique indispensable : il déplace l’attention de la performance individuelle vers la puissance d’agir partagée, condition nécessaire à toute transition socioécologique juste.
Par Charles-Antoine Bachand, Professeur, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.