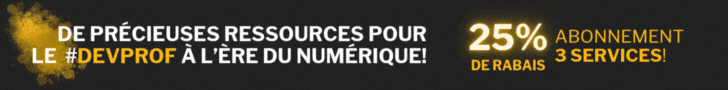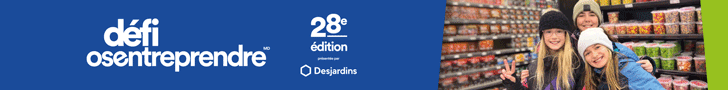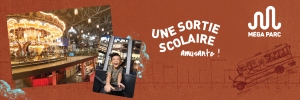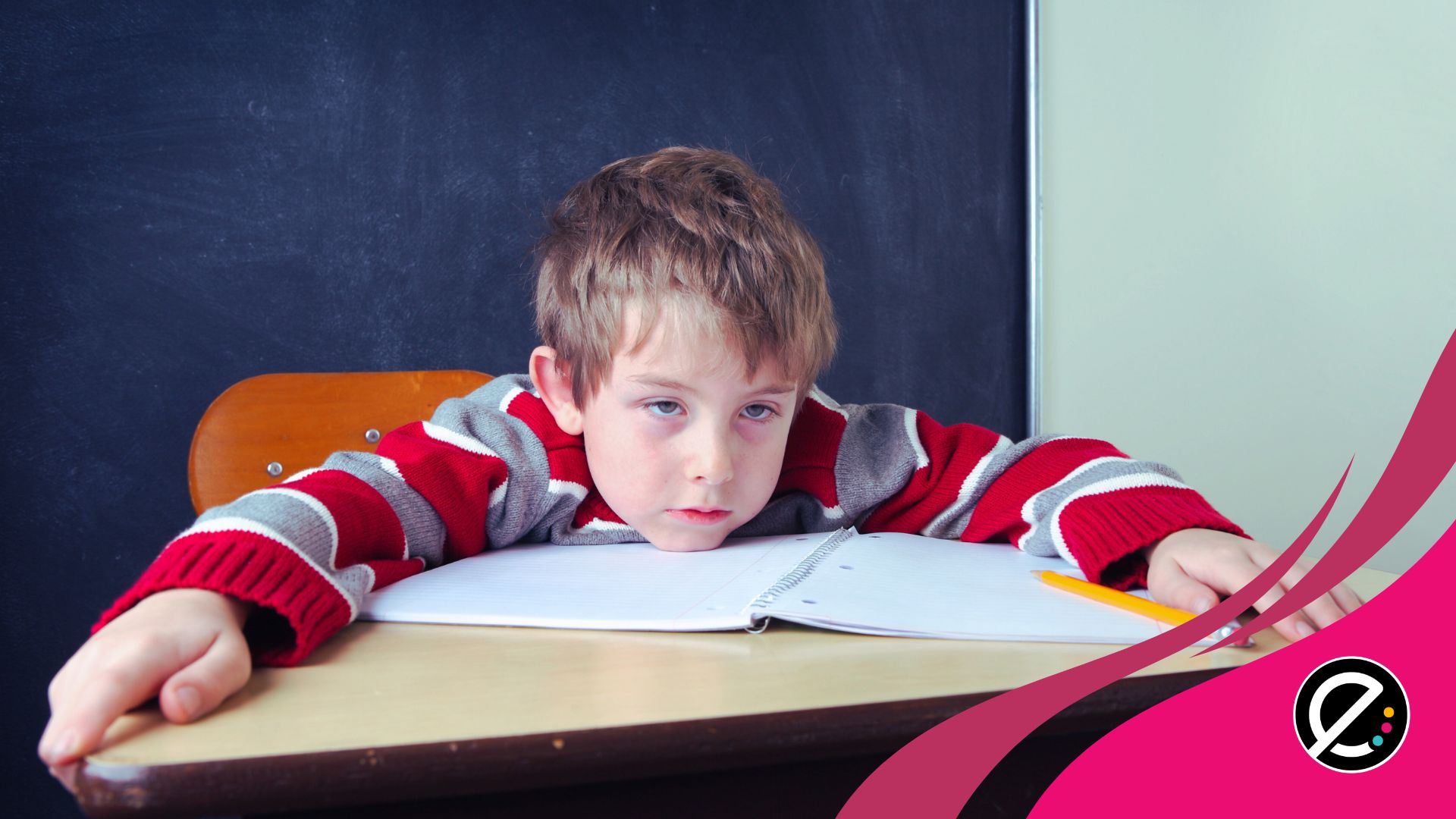Par Caroline Damboise, Université du Québec à Rimouski (UQAR) et Thomas Rajotte, Université du Québec à Rimouski (UQAR)
L’implantation des premiers laboratoires créatifs dans les milieux scolaires, artistiques, industriels et communautaires a été initiée à la fin des années 1990 par l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT). Graduellement, le phénomène a pris de l’expansion et s’est répandu à l’échelle mondiale. Au Québec, cela se traduit, notamment, par l’émergence de laboratoires créatifs dans des milieux scolaires.
En tant que professeurs-chercheurs spécialisés respectivement en technologies éducatives ainsi qu’en didactique et orthopédagogie des mathématiques au primaire à l’Université du Québec à Rimouski, nous nous sommes intéressés au potentiel de ces dispositifs afin de favoriser l’engagement et la qualité des apprentissages des élèves.
La grande idée derrière un laboratoire créatif
Un laboratoire créatif, c’est un environnement relativement flexible mettant plusieurs outils à la disposition des personnes participantes.
Par exemple, on peut y retrouver des imprimantes 3D, des ordinateurs, des robots, des presses à macarons, ou une machine pour découper du vinyle (Cricut). Cet aménagement permet de concevoir, de fabriquer ou de développer un projet afin de répondre à un objectif que l’on aimerait atteindre.
Le projet peut toucher les arts, la robotique, ou encore le numérique. Dans ces environnements, l’erreur fait partie du processus d’apprentissage et permet d’améliorer le projet ou le prototype construit.
Les laboratoires créatifs dans les écoles
Soutenir le plaisir d’apprendre, motiver les élèves à l’école et leur donner des occasions de vivre des situations leur permettant d’exploiter leur potentiel demeure tout un défi dans les classes pour les enseignants. Les laboratoires créatifs peuvent à cet égard constituer une occasion intéressante à exploiter dans les écoles.
Un rapport du Laboratoire de formation et de recherche sur la littératie numérique de l’UQAC fait mention de valeurs se retrouvant au sein des laboratoires créatifs et de la philosophie derrière ces milieux. L’autonomie, la créativité, la collaboration et l’aspect ludique en sont quelques exemples.
Les observations et entrevues réalisées dans le cadre du projet de recherche débuté en 2022 ont confirmé ces propos. S’agissant par exemple de la collaboration, nous avons pu observer dans certaines situations des élèves de cinquième ou sixième année aider des élèves plus jeunes.
D’ailleurs, le cadre non traditionnel des labos créatifs permet à beaucoup d’élèves de s’investir dans des projets tout en faisant des apprentissages de manière moins formelle, mais tout aussi utile. En permettant aux élèves de choisir un projet selon leurs intérêts, plusieurs types d’élèves y trouvent leur compte, notamment les élèves ayant davantage de difficultés à performer au niveau académique.
Des exemples de projets issus des laboratoires créatifs
Dans le cadre d’un projet, un élève peut par exemple développer un objet grâce à la modélisation, puis imprimer son prototype au moyen d’une imprimante 3D. L’élève peut ainsi créer une décoration spéciale pour son arbre de Noël, ou encore réaliser un porte-clés pour ses parents.
Le tout peut aussi se faire en utilisant le bois ou encore la pyrogravure.
En se prêtant à ces différentes activités, les enfants peuvent développer leur autonomie et leur esprit d’initiative tout en étant encadrés par les enseignants. Cela leur permet également d’explorer leurs intérêts, et peut-être même de les orienter vers un domaine professionnel futur.
L’utilisation de la robotique pédagogique peut constituer une expérience particulièrement riche dans un contexte de laboratoire créatif. Les élèves peuvent par exemple faire des compétitions entre des robots conçus de toutes pièces par eux, faire un véhicule en LEGO motorisé répondant à certaines caractéristiques précises, ou encore concevoir une danse avec un robot.
Le marché de l’emploi est de plus en plus lié aux technologies qui peuvent parfois coûter assez cher. Certains enfants, notamment défavorisés, n’y ont donc pas accès. Les labos créatifs peuvent remédier à ce problème en mettant à la disposition des élèves toutes sortes d’appareils, comme une imprimante 3D. Ils familiarisent par le fait même les enfants avec des technologies analogues à celles avec lesquelles ils devront composer une fois adultes.
Des élèves engagés dans la résolution de problèmes motivants
Un avantage indéniable que permettent les laboratoires créatifs découle du fait que l’atteinte des objectifs spécifiques à chaque projet favorise la prise de risque et l’engagement des élèves en contexte de résolution de problèmes.
En effet, dans le milieu scolaire, il n’est pas rare de voir des élèves éviter de s’impliquer dans les activités proposées de peur de vivre un échec. De plus, dans un contexte d’éducation inclusive, les laboratoires créatifs constituent un excellent levier permettant de faciliter la différenciation de l’enseignement afin de tenir compte des intérêts et des caractéristiques de chacun.
Cela est essentiellement attribuable au fait que chaque élève, en fonction de son niveau d’aisance respectif vis-à-vis le projet proposé, sera en mesure de formuler ses propres objectifs et de s’engager au sein d’une activité qu’il pourra mener à terme. Dans ces contextes, les élèves peuvent donc développer leur compétence de résolution de problèmes en s’interrogeant sur ce qui fait que leur projet ou leur prototype ne fonctionne pas.
Des témoignages sans équivoque
Un laboratoire créatif a par exemple été mis sur pied en septembre 2022 à l’école L’Oiseau-Chanteur de Saint-Mathieu-de-Rioux dans le Bas-Saint-Laurent. Tout au long de l’année scolaire, une trentaine d’élèves ont ainsi pu mettre à l’épreuve leur créativité en participant à une foule de projets.
À ce sujet, Mélissa Couillard, une enseignante de l’établissement, rapporte que les activités réalisées dans les laboratoires créatifs permettent aux élèves de relativiser leur rapport à l’erreur : « Ce n’est pas un échec pour eux. Ils collaborent pour trouver des solutions et des stratégies pour régler les problèmes qu’ils rencontrent ».
Bien que ce type d’environnement demande un investissement de la part des enseignants et un certain lâcher-prise, les élèves apprécient l’occasion qui leur est donnée de pouvoir investir des projets moins académiques, mais tout aussi éducatifs.
D’ailleurs, un élève moins performant au niveau académique peut justement tirer son épingle du jeu dans le contexte des laboratoires créatifs. Ainsi, Marie-Pier Gauthier, également enseignante de l’établissement, précise qu’elle a eu l’occasion d’observer des élèves qui vont particulièrement briller dans cet environnement, alors que le côté académique est peut-être moins valorisant pour eux.
Vers une collaboration des milieux scolaires et communautaires ?
Les bienfaits des laboratoires créatifs ne se limitent pas au milieu scolaire. Cet environnement peut aussi bénéficier à la communauté sans égard à l’âge des personnes qui s’engagent au sein d’un projet créatif se rapportant à un objectif personnel.
Les défis intellectuels rattachés à chacun des projets contribuent à tisser des liens entre les membres de l’environnement qui peuvent s’entraider et collaborer afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif préalablement fixé.
Ainsi, on pourrait même envisager une collaboration avec des organismes du milieu communautaire qui pourraient venir offrir du soutien dans la réalisation de certains projets, ou encore favoriser un transfert de connaissances.
Par Caroline Damboise, Professeure en technologies éducatives, Université du Québec à Rimouski (UQAR) et Thomas Rajotte, Professeur en didactique et orthopédagogie des mathématiques, Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.