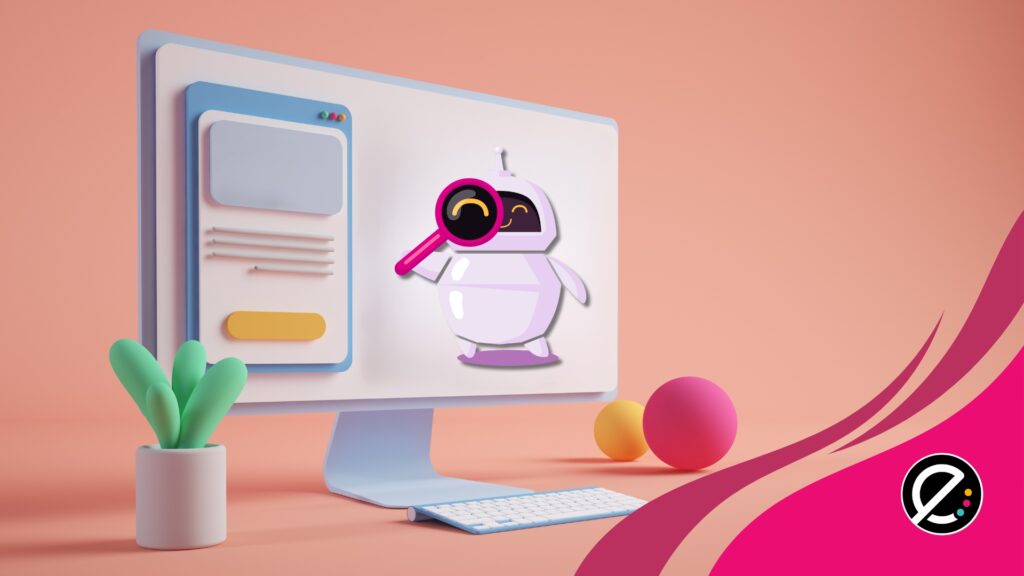Avec l’émergence des outils d’intelligence artificielle générative, la question de l’intégrité intellectuelle en milieu scolaire suscite de vifs débats. Pour Noémie Verhoef, enseignante de philosophie au Cégep de Victoriaville, le constat est clair : le retour au papier-crayon ne réglera pas les défis soulevés par l’IA. Il faut plutôt repenser l’évaluation et l’enseignement à la lumière de cette nouvelle réalité. Dans un récit de pratique présenté dans le cadre d’un webinaire de l’Association québécoise de pédagogie collégiale, elle a partagé l’évolution de sa posture, passée de la détection à l’encadrement, au cours des trois dernières sessions.
C’est à l’hiver 2024, après avoir constaté un nombre important de plagiats dans le travail de mi-session qu’elle demandait depuis toujours, que l’enseignante a décidé de revoir sa pratique. « ChatGPT a assassiné mon évaluation », confie-t-elle. D’abord tentée par un retour aux méthodes traditionnelles, elle a plutôt choisi de s’attaquer au cœur du problème : le contexte de réalisation du travail.
« Il ne suffit pas de bannir l’IA pour garantir l’intégrité des évaluations. Le plagiat existait avant l’arrivée de l’IA. »
Son projet d’évaluation — une demi-dissertation basée sur une question philosophique — a ainsi fait l’objet de plusieurs itérations, au fil des sessions. Le principe de base : permettre un usage balisé de l’IA, tout en guidant les étudiants dans un processus de recherche et de réflexion authentique.
Enseigner les méthodes de travail
Depuis quelques années, elle remarque que les compétences informationnelles et les méthodes de travail des étudiants sont en baisse. « Comment chercher de l’information, comment citer des sources, comment créer des notes de bas de page. Ils ne savent pas et cela les insécurise lorsque vient le temps de réaliser les travaux », dit-elle. Ils peuvent alors être tentés de se tourner vers des solutions simples, comme l’IA.
L’enseignante a donc revu progressivement l’encadrement offert aux étudiants :
- Séances en bibliothèque avec accompagnement de la bibliothécaire pour développer des méthodes de recherche et de travail efficace,
- Enseignement explicite de la méthodologie,
- Introduction de nouvelles capsules en classe inversée pour maximiser le temps en présence,
- Journal de bord à compléter par les étudiants au terme des 6 h de cours de travail dirigé offert,
- Contrat d’intégrité intellectuelle à signer par les étudiants, qui comprend les bonnes manières de citer l’IA dans un travail,
- Usage permis, mais limité de l’IA pour des tâches précises comme la prospection d’arguments ou le résumé d’articles scientifiques.
Les 6 heures de cours en travail dirigé devraient servir à monter le plan et les arguments. La demi-dissertation doit ensuite être rédigée dans un document, dont le suivi des modifications est activé et verrouillé, fourni par l’enseignante dans Teams.
Des résultats probants et un climat plus serein
En un an, les effets de cette approche ont été significatifs. Selon les données compilées par l’enseignante, le taux de plagiat a chuté, passant de 10 cas sur 89 élèves à 4 sur 118. La proportion d’élèves ne remettant pas du tout leur travail a, elle aussi, diminué, passant de 10 % à 4 %. Surtout, l’ambiance en classe a changé, dit-elle. Elle note plus de discussions ouvertes et collectives, ainsi qu’une implication accrue des étudiants dans leur propre processus d’apprentissage.
Comme elle l’a raconté lors du webinaire, plutôt que de jouer au détective, Noémie Verhoef a choisi de redevenir enseignante. « Tout problème pédagogique mérite une réponse pédagogique », affirme-t-elle. Pour elle, les détecteurs d’IA ou les mesures purement technologiques créent souvent un cercle vicieux; les technologies de détection seront toujours de plus en plus performantes et on ne s’en sortira pas.
Elle est désormais convaincue, qu’à l’inverse, une planification rigoureuse, un encadrement intentionnel des étudiants et des activités signifiantes permettent de mobiliser les jeunes, de renforcer leur motivation et de bâtir une relation pédagogique solide avec eux. « Quand tu as une bonne relation avec ton prof, c’est plus gênant de tricher. »
L’IA, oui, mais pas à n’importe quel prix
Noémie a néanmoins une approche nuancée face aux technologies à l’école. Si l’IA peut jouer un rôle utile, notamment comme tuteur ou outil de résumé, elle ne doit pas prendre la place du travail intellectuel de l’élève. « L’IA, c’est bien, mais l’être humain, c’est mieux », résume l’enseignante.
Son approche vise donc à restaurer le sens de l’évaluation et à former les jeunes à la liberté par la responsabilité. C’est pourquoi elle mise de plus en plus sur des réflexions en groupe, la socialisation et la co-construction du savoir.
« Former à la liberté, c’est former à la responsabilité. Il faut donner des balises claires aux élèves, c’est ainsi qu’ils se réapproprient leur espace. Ils sont au centre de leur apprentissage, ce n’est pas nouveau, mais cela doit être dit et expliqué. »
À la session d’automne 2025, le journal de bord deviendra une activité sommative pour encourager les étudiants à le compléter plus consciencieusement. De plus, le travail de recherche d’arguments, plutôt que de se faire avec l’IA, fera l’objet d’une discussion en classe où les étudiants discuteront entre eux pour s’entraider à identifier des arguments pour leur travail philosophique. L’IA y sera toujours permise dans certains usages ciblés, comme les résumés de recherches.
« Avant l’IA, les étudiants arrivaient à concevoir des questions philosophiques. Il n’y a pas de raison pour laquelle une personne ne puisse plus en être capable aujourd’hui. »
Pour Noémie Verhoef, ce changement de posture a été bénéfique. « C’est un changement de posture qui fait beaucoup de bien. » Il a redonné du sens à son enseignement, tout en respectant l’autonomie et l’intelligence des élèves.
En complément :
- Encadrement de l’IA en enseignement supérieur : des syndicats d’enseignants déplorent la lenteur de Québec à agir
- La deuxième chance de Tristan, surpris à plagier ChatGPT
Visionner le webinaire