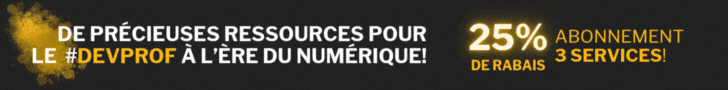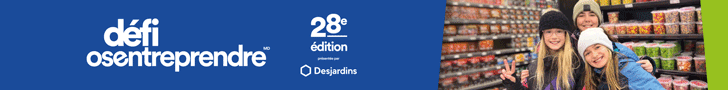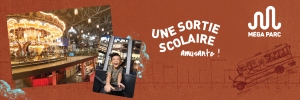Canada – Si dessiner, écrire, attraper un ballon, faire du vélo, s’habiller, se laver, et même manger, semblent laborieux pour un enfant, la dyspraxie en est peut-être la cause.
La dyspraxie est un trouble de coordination, de planification et de production motrice, selon l’Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA). Présente dès la naissance, la dyspraxie se caractérise par une immaturité de la région du cerveau qui dirige la séquence de mouvements nécessaire afin d’accomplir un acte moteur.
La dyspraxie n’est pas un trouble d’origine musculaire ni une déficience intellectuelle. Les capacités de compréhension et de raisonnement ne sont aucunement affectées. La personne dyspraxique est capable d’exprimer clairement le but qu’elle veut atteindre et les moyens à prendre pour l’atteindre.
Par exemple, l’enfant est capable de dire : « Je veux attacher mes lacets » et peut même décrire la séquence de mouvements requis pour les attacher. En apparence, l’enfant a l’air de fonctionner tout à fait normalement. C’est pourquoi on parle souvent du « handicap fantôme ».
Concrètement, la dyspraxie est un trouble d’apprentissage relié au « comment faire ». Elle se répercute dans toutes les activités quotidiennes, et ce, dès l’enfance. Par le fait même, l’acquisition de l’autonomie par l’enfant se fait beaucoup plus lentement et tardivement. L’aide des parents et de l’entourage est requise plus longtemps pour éviter que l’enfant dyspraxique se retrouve sans cesse face à des situations d’échec.
La diversité des apprentissages qui se font au cours des premières années de vie représente un réel défi pour les enfants dyspraxiques. Ce défi se transforme souvent en une longue période de stress et d’inquiétude pour l’enfant. Il ne parvient pas à réaliser certaines activités au même rythme que ses pairs et régulièrement, il n’y parvient tout simplement pas.
Types de dyspraxie
Des études estiment qu’environ 10 % des enfants sont dyspraxiques, selon l’AQETA. Ce qui représente entre deux et trois enfants dyspraxiques par classe. Il existe deux types de dyspraxie : dyspraxie orale et dyspraxie motrice.
La dyspraxie orale concerne la coordination des muscles de la langue, des lèvres, de la mâchoire et du palais. La séquence de mouvements articulatoires nécessaires à la transformation des sons en mots se fait difficilement. Ce qui entraîne généralement un retard du langage. Plus précisément, les mots sont mal articulés, le langage n’est pas clair et le débit et l’intensité de la parole sont difficilement contrôlés.
La dyspraxie motrice, quant à elle, touche la coordination des muscles et des articulations du corps. Les séquences de mouvements et de gestes permettant de réaliser un acte moteur sont perturbées.
Difficultés à tous âges
Des difficultés causées par la dyspraxie, principalement la dyspraxie motrice, sont présentes autant à l’âge préscolaire et scolaire qu’à l’âge adulte.
Chez le tout-petit, on observe un retard dans les activités comme se rouler, s’asseoir, se lever et marcher. Tenir son équilibre, courir, sauter, monter et descendre les escaliers, tenir un crayon, manipuler les ustensiles et bricoler sont des actions où il éprouve des difficultés.
Un peu plus tard, à l’âge scolaire, l’enfant dyspraxique rencontre les mêmes difficultés, en plus de celles qui s’ajoutent. Par exemple, il est difficile pour lui d’organiser son sac d’école ou d’attacher ses lacets. Les cours de lecture, d’écriture, de géométrie et d’éducation physique sont particulièrement problématiques.
L’adulte dyspraxique fait aussi face à de nombreux défis quotidiens comme se raser, se maquiller et se coiffer. Accomplir les tâches ménagères pose aussi problème. L’utilisation d’un ouvre-boîte, par exemple, représente tout un casse-tête pour une personne dyspraxique.
Interventions
Une évaluation complète de l’enfant par un neuropsychologue est nécessaire pour diagnostiquer la dyspraxie. Si l’évaluation indique une dyspraxie orale, un plan de rééducation intensif en orthophonie est conseillé. Si l’évaluation correspond à une dyspraxie motrice, un plan de rééducation en ergothérapie est plutôt suggéré.
L’école semble être un milieu particulièrement problématique pour un dyspraxique puisque les parents ne sont pas là pour l’encourager et l’aider. C’est pourquoi il est très important de favoriser l’intégration des enfants dyspraxiques et d’adapter certaines tâches.
Les enseignants et autres intervenants doivent fournir à l’enfant des trucs comme utiliser une règle pour suivre la ligne et ainsi, faciliter la lecture. Tolérer une écriture imparfaite et maximiser le travail fait à l’oral peuvent également aider l’enfant. Dans les cours d’éducation physique comme en mathématiques, il est primordial de séparer en étapes simples ce qu’il faut faire. Allouer un peu plus de temps à l’enfant peut aussi être une bonne solution. L’objectif est de favoriser l’estime de soi.
En complément, Vivre la dyspraxie, le blogue de Sylvie Breton, vice-présidente de l’Association québécoise pour les enfants dyspraxiques (AQED), est riche en conseils. Toutefois, l’AQED, un organisme à but non lucratif qui offre du soutien aux parents, ne possède pas de site web. Pour informations, écrivez à [email protected]
Par Marie-Christine Leblanc