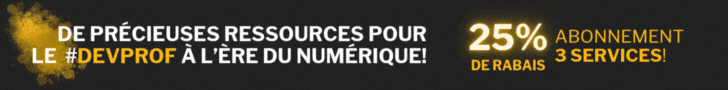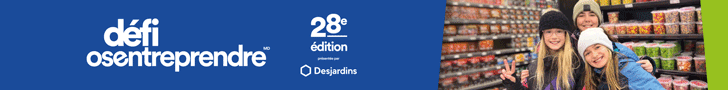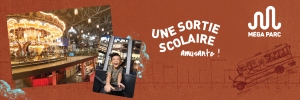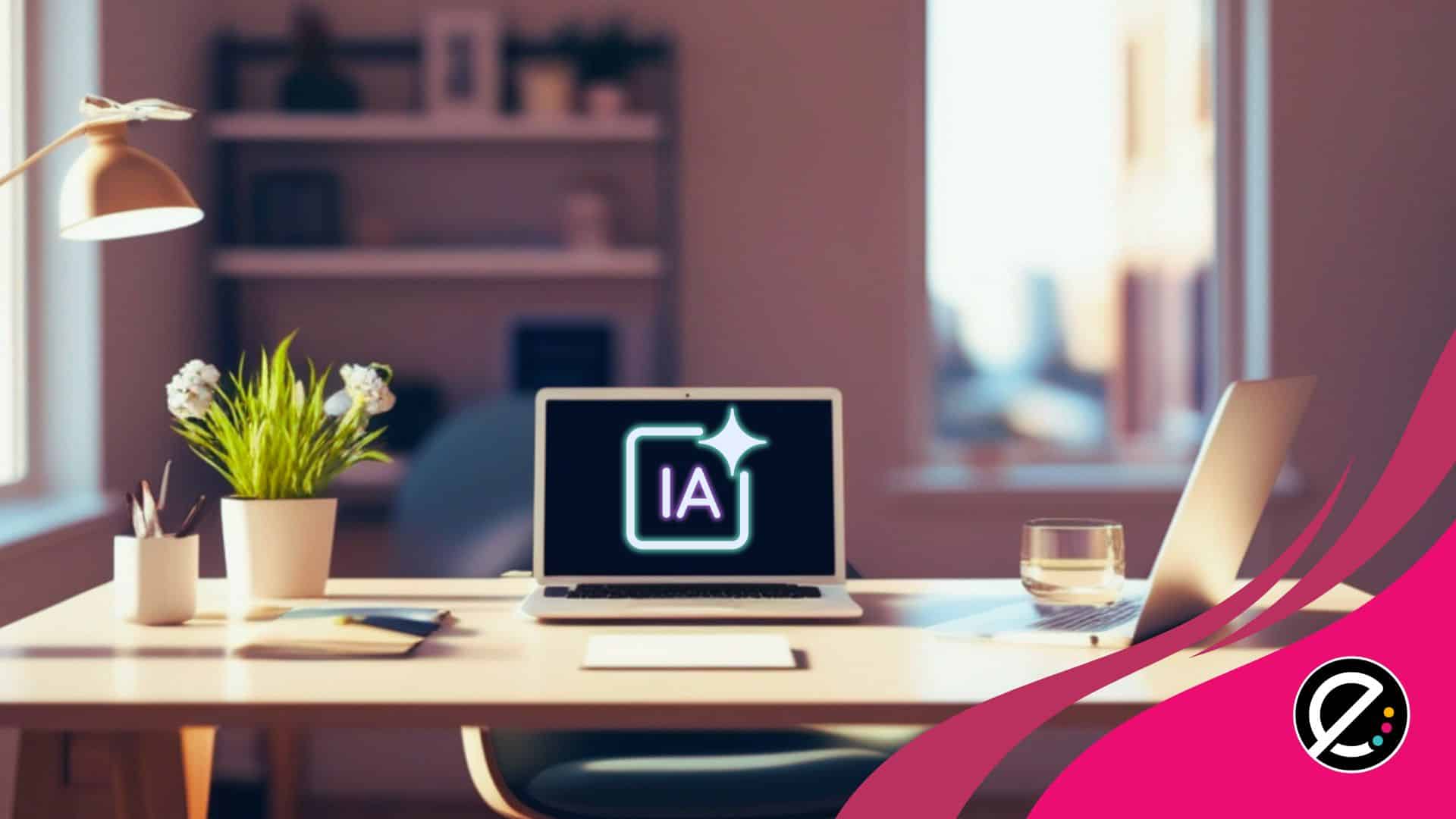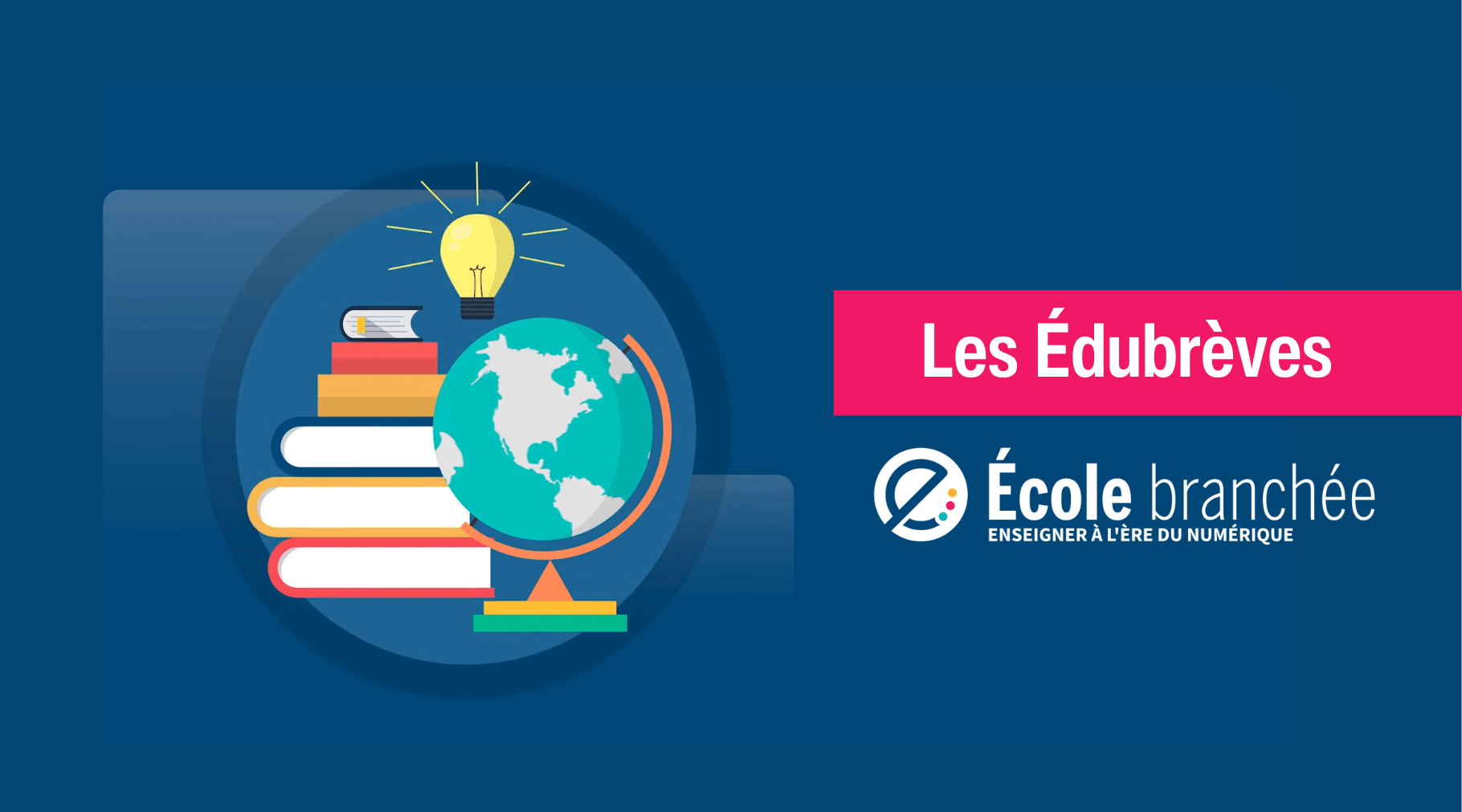
Les #Édubrèves – 17 février 2026
Au menu des #Édubrèves cette semaine : la persévérance scolaire à l’honneur, avec un clin d’œil au numérique comme levier d’engagement et de motivation. Aussi, plusieurs appels à participation et à propositions (ACELF, ACFAS, culture scientifique), des initiatives inspirantes pour les écoles, des ressources pour soutenir la réussite en mathématiques, ainsi qu’un agenda bien rempli de formations et rendez-vous autour de l’IA et de la pédagogie. Bonne lecture!