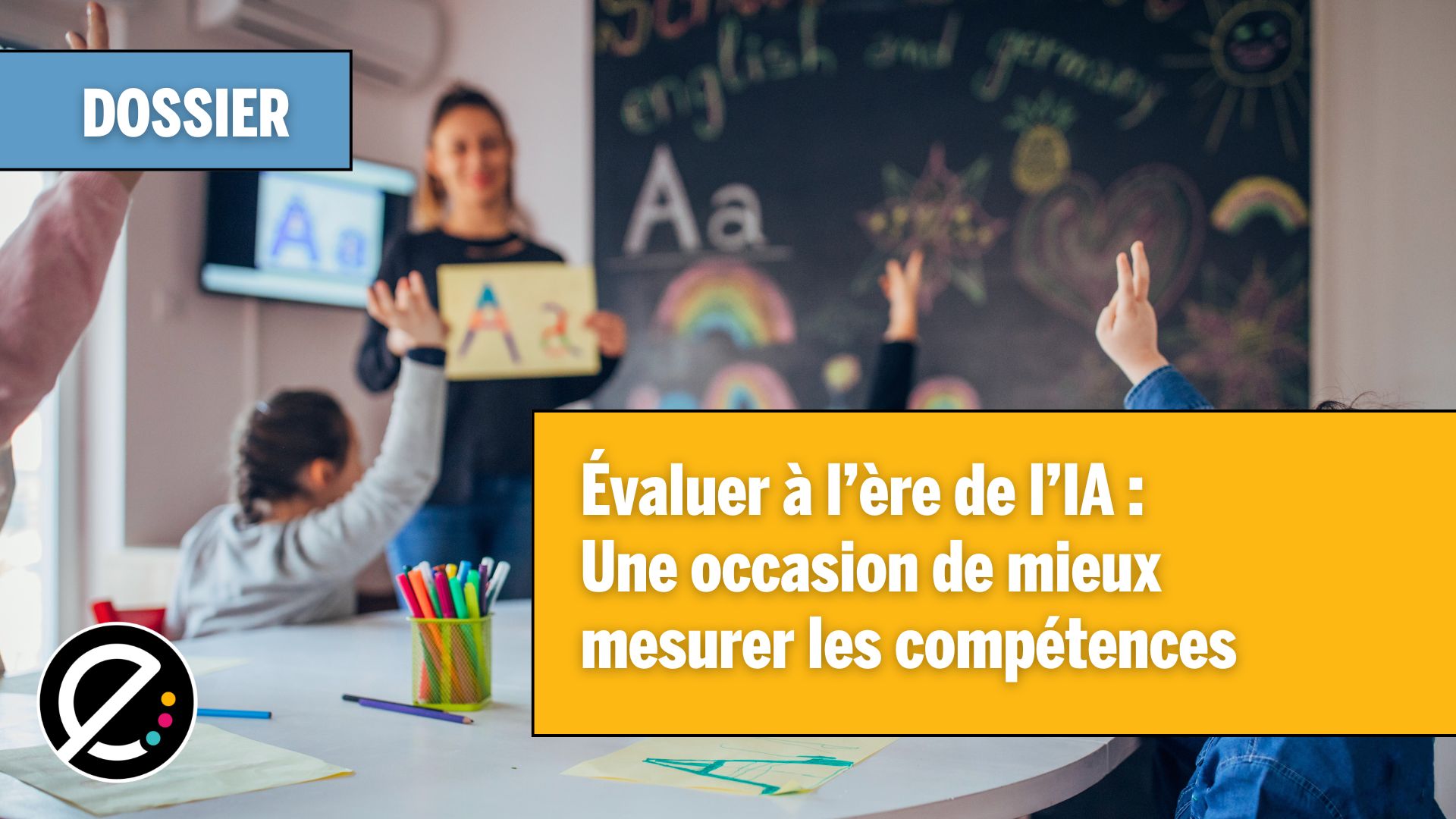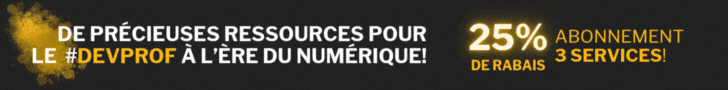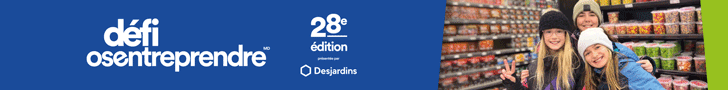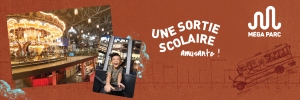Par École branchée
À travers ce document, la CEST formule 16 recommandations concrètes destinées à accompagner les décideurs publics vers une démarche de sobriété numérique. Un message central s’en dégage : les technologies numériques, bien qu’essentielles à la vie contemporaine, doivent être utilisées de manière responsable, réfléchie et en cohérence avec les principes du développement durable.
Comprendre les effets réels du numérique
La CEST rappelle que les termes comme « virtuel » ou « infonuagique » masquent une réalité bien tangible : celle d’un vaste réseau d’infrastructures matérielles (centres de données, objets connectés, câbles sous-marins) qui consomme d’énormes quantités d’énergie et de ressources naturelles. Ces technologies, omniprésentes dans les sphères économiques, sociales et éducatives, laissent une empreinte environnementale difficilement visible, mais bien réelle.
L’avis souligne l’urgence de mieux informer la population sur ces enjeux. Une meilleure littératie environnementale du numérique est jugée essentielle, tant pour encourager une participation citoyenne éclairée que pour mobiliser les milieux de pratique, dont celui de l’éducation.
Un appel à l’action pour les décideurs publics
Parmi les 16 recommandations proposées par la CEST, plusieurs s’adressent directement aux autorités gouvernementales et aux organismes publics. On y retrouve, entre autres, l’appel à :
- Favoriser l’éducation à la sobriété numérique dès le plus jeune âge, notamment en intégrant ces enjeux dans les programmes scolaires (recommandation 11) ;
- Encourager les établissements d’enseignement à adopter des pratiques numériques durables, en priorisant l’achat d’appareils réutilisables ou réparables (recommandation 9) ;
- Renforcer la formation continue du personnel enseignant et des intervenants scolaires sur les impacts environnementaux du numérique et les bonnes pratiques à adopter (recommandation 12) ;
- Mettre en place des politiques numériques claires et éthiques au sein des institutions publiques, incluant le milieu scolaire, pour guider les usages et l’achat technologique (recommandations 4 et 10).
Ces recommandations visent à inscrire la sobriété numérique comme un principe structurant dans l’ensemble des décisions publiques liées aux technologies.
Des principes éthiques pour éclairer les choix
L’avis de la CEST s’appuie sur une réflexion éthique, articulée autour de principes tels que la responsabilité, l’équité, la durabilité et la transparence. Selon le CEST, l’idée de sobriété numérique ne s’oppose pas à l’innovation, mais propose une vision plus équilibrée de la transformation numérique. Elle valorise l’autonomie des collectivités, la pensée critique des citoyens et la recherche d’un véritable bénéfice social et environnemental.
Pour les milieux de l’éducation, cette vision invite à revoir certains réflexes liés à la technologie. Plutôt que d’intensifier les usages numériques de manière systématique, il s’agit de se questionner sur leur pertinence pédagogique, leur efficacité réelle et leur coût écologique. Cela suppose de faire des choix éclairés, de prioriser la qualité sur la quantité, et de sensibiliser les jeunes générations à leur propre pouvoir d’agir.
Le rapport complet, incluant les 16 recommandations, est accessible sur le site de la Commission de l’éthique en science et en technologie du Québec.