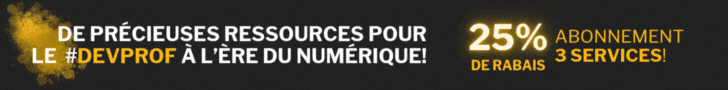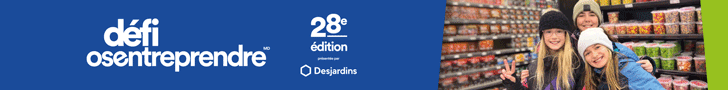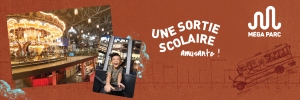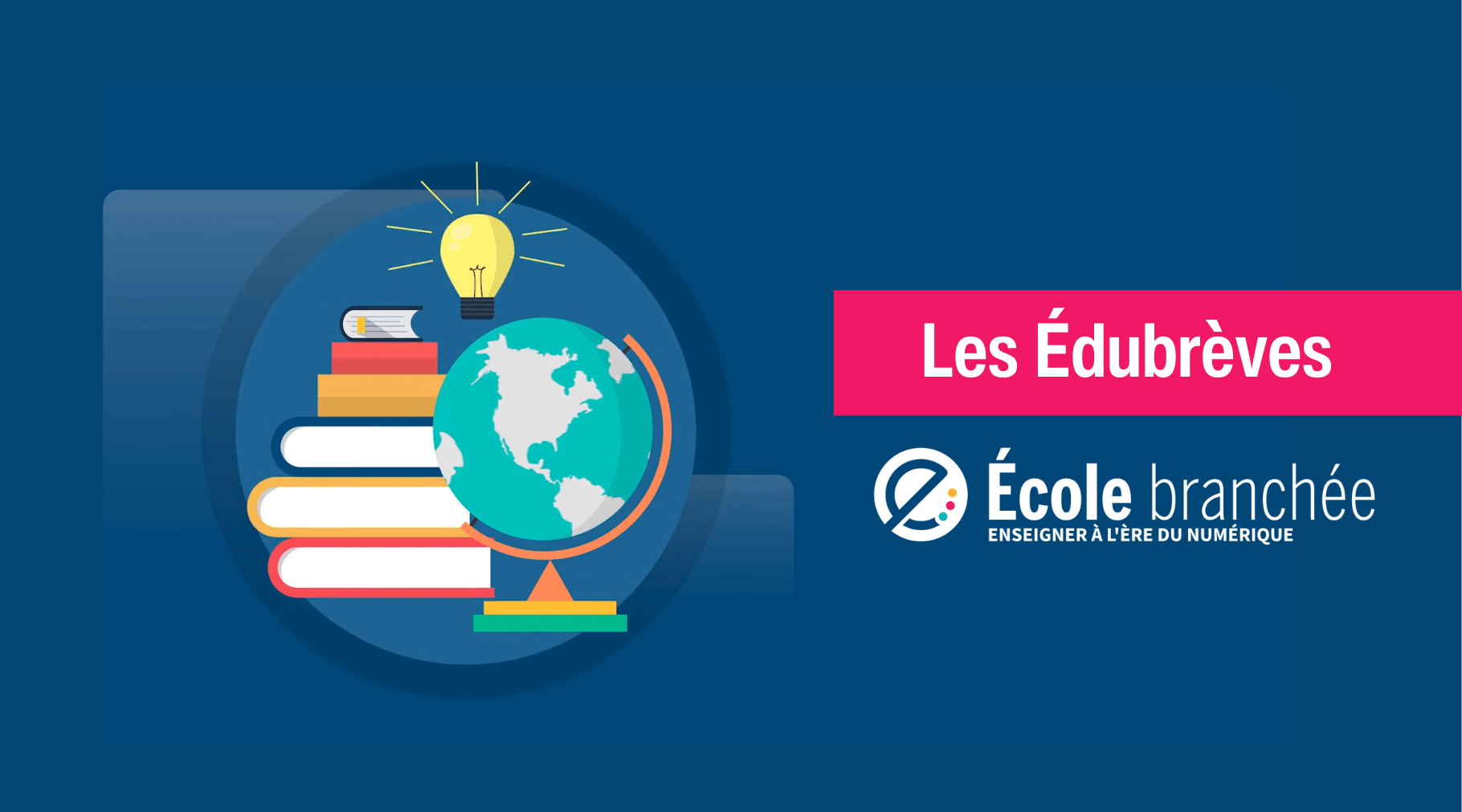Par Marc-André Girard
Grâce à une simple discussion sur LinkedIn, je suis replongé dans des discussions que j’ai eues par le passé et je me suis souvenu avoir été frappé par une simple phrase dans l’essai doctoral de Sylvie Normandeau (2021) où elle écrit qu’« en [s]’engageant dans le doctorat professionnel en fin de carrière, [elle] quittait [s]a posture d’experte » (p. 67). Cette citation m’avait alors laissé perplexe, car j’étais en train de vivre cette même démarche académique avec le but de faire de moi un expert.
Ma motivation était la suivante : le domaine de l’éducation est insondable dans son ensemble et fait appel à plusieurs autres concepts issus des sciences humaines : anthropologie, philosophie, psychologie, histoire, etc. Désormais, en éducation, tout le monde a son opinion, mais je voulais m’appuyer sur la recherche, les faits, les données probantes et tout ce qui est produit par la science et ses chercheurs pour étayer la mienne.
Je visais alors le passage de l’incertitude vers l’expertise. Toutefois, j’aurais dû me souvenir de mes cours de philosophie socratique du cégep : « tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien ». Après une démarche doctorale de six ans à côtoyer des personnes qui en connaissent pas mal plus que moi, le corolaire de cette maxime est devenu : « plus j’en apprends, moins j’en sais ».
Les études supérieures ont cette vertu d’injecter une bonne dose d’humilité aux étudiants et étudiantes. J’ai beau détenir une expertise basée sur des études supérieures et sur plus de 25 années d’expérience en milieu scolaire, il n’en demeure pas moins que « l’expert » que je suis doit adopter une posture de flexibilité, d’ouverture et d’écoute. Cela écrit, j’ai plutôt appris à « vivre la tension entre le questionnement et la valorisation des pratiques existantes, entre la reconnaissance et la suspicion, entre la critique et la solidarité, entre le respect de l’expertise du personnel enseignant et l’évolution du métier (…) » (Guillemette, Vachon et Guertin, 2019, p. 8).
Entre expertise et incertitude : un équilibre délicat
En cherchant à m’affirmer comme expert, inconsciemment, j’avais probablement l’intention outrecuidante et désinvolte de juger de ce qui est bien ou ne l’est pas en éducation, ce qui doit y être fait ou ce qui doit y être évité alors que, dans les faits, « il y a une obligation de tenir les deux termes en équilibre » (Guillemette, Vachon et Guertin, 2019, p. 8) : celui de la certitude de l’existant et celui de l’incertitude des possibilités autres.
Ce que je retiens de tout cela est double. Premièrement, quand nous devenons enseignant ou direction d’école, nous sommes dans une situation de pouvoir. La connaissance, c’est la puissance : celle du programme, de la pédagogie, des élèves et de tout ce qui entoure la vie scolaire. Après quatre années de baccalauréat qui peuvent précéder des études supérieures, avec une expérience qui s’ajoute lentement, mais sûrement à un parcours scolaire prometteur, l’expertise se tisse un jour à la fois. Plus les jours s’accumulent, plus le tissage est serré, fiable et solide. Or, cela devrait être le contraire : plus l’expérience s’acquiert, plus les connaissances se cumulent, plus on est conscient de l’immensité de notre domaine d’action, de sa complexité, de ses ramifications souvent impénétrables et, en conséquence, moins on en sait. Plus on s’investit dans des activités de développement professionnel ou de formation continue, plus on se rend compte qu’on n’en sait que trop peu. Tout ce que nous tenions pour acquis devient… incertain. Rien n’est noir ou blanc. Tout est dans la nuance, la subtilité.
L’éducation n’échappe malheureusement pas aux discours polarisants à la mode depuis quelques années et adopter une posture privilégiant l’incertitude plutôt que l’expertise permet de mieux comprendre toute la bigarrure qui anime un domaine marqué par les interactions sociales entre des gens qui manifestent des besoins divers. Effectivement, « le praticien qui agit selon le paradigme de l’incertitude s’appuie sur ce qu’il y a d’unique et d’incertain dans chaque interaction pour s’autoréguler dans l’action » (Saint-Arnaud, 2002). En suivant le principe que chaque élève est unique, ce paradigme nous incite à apprivoiser la complexité et à poursuivre notre évolution professionnelle. Nous gardons une posture d’ouverture qui accueille cette complexité comme un défi pour mieux accompagner les élèves de notre classe qui forment une mosaïque de besoins alambiqués.
La posture héritée du « maître dans sa classe » est certainement sujette à faire de nous des experts, mais, à mon sens, cela nous détourne d’un paradigme d’incertitude qui permet, grâce à cette posture d’ouverture et de curiosité, une meilleure adaptation aux besoins des élèves (Saint-Arnaud, 2002).
Deuxièmement, le paradigme de l’incertitude nous incite à collaborer avec d’autres pour cocréer des savoirs professionnels destinés à étoffer nos pratiques professionnelles visant à mieux intervenir auprès des élèves. Cela revient à ne pas tenir pour acquis que nos interventions comblent nécessairement les besoins de chacun de nos élèves. De plus, une prise de conscience émerge remettant à l’avant-plan le principe de désirabilité de ces interventions mérite de mieux comprendre lesdits besoins pour déployer efficacement nos énergies professionnelles. N’est-ce pas le fondement de l’autonomie professionnelle? Le paradigme de l’incertitude ouvre des espaces dialogiques féconds, rend possible la cocréation et, ultimement, il propulse l’innovation.
Sylvie Normandeau (2020) ne saurait proposer une meilleure conclusion : « c’est en acceptant l’incertitude qu’on avance sur le chemin, à condition, bien entendu, de réaliser que c’est en se perdant qu’on s’y retrouve » (p. 75).
Références :