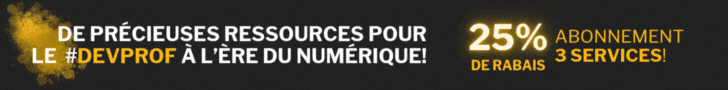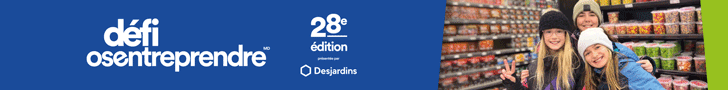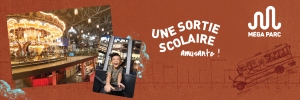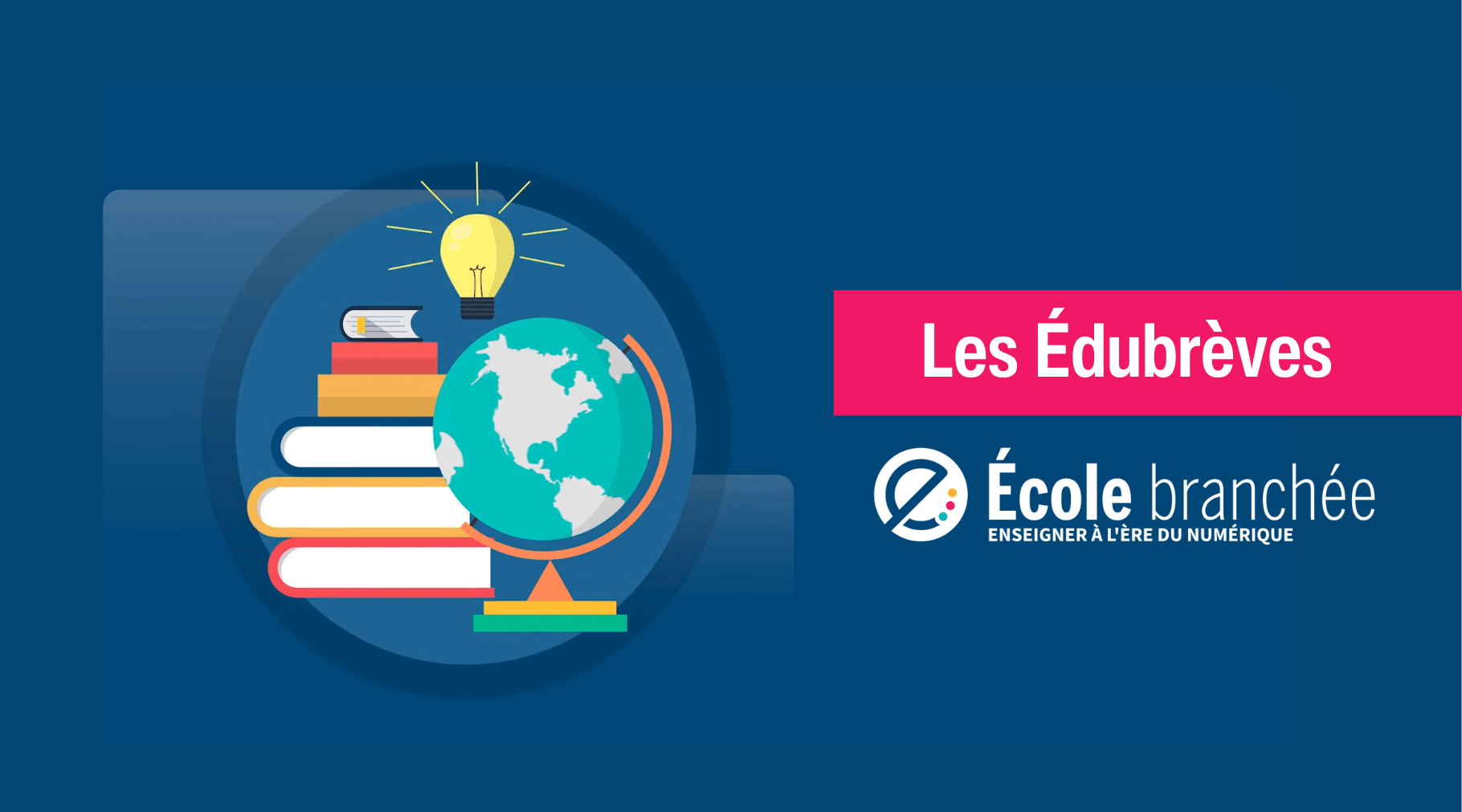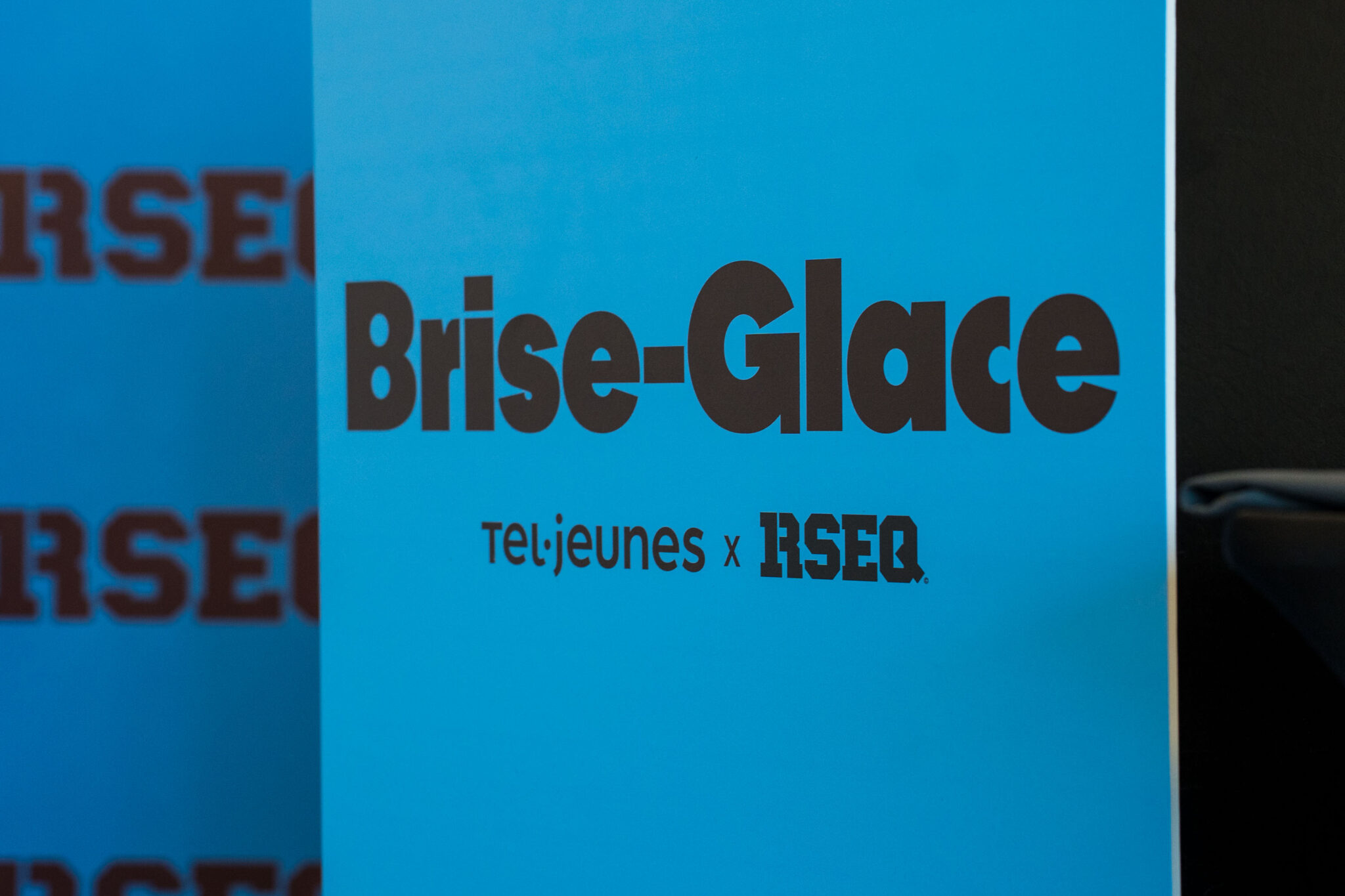L’étude, menée sous la direction de Mélissa Goulet et Jonathan Bluteau, professeurs à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), s’est appuyée sur des données issues des six écoles québécoises, construites dans le cadre du projet Lab-École. Le rapport final met en lumière les bienfaits d’une approche intégrée combinant architecture, pédagogie, bien-être et collaboration.
Comme l’a souligné Dominique Savoie, directrice générale du Lab-École, « les résultats sont positifs et satisfaisants. Le rapport met en évidence l’importance de penser la réussite éducative de façon globale et de voir l’école comme un milieu de vie ».
Pour la professeure Mélissa Goulet, « les retombées positives du projet Lab-École sont associées à la combinaison des facteurs qui soutiennent le sentiment de bien-être, la motivation, la mobilisation et le développement de tous les acteurs. » Elle précise que « la philosophie Lab-École est transférable dans n’importe quel environnement scolaire ». Elle souhaite d’ailleurs que les résultats de la recherche servent d’inspiration pour construire (au sens propre comme au figuré) les écoles de demain.
Méthodologie et cadre de recherche
Le projet a été mené auprès de 469 élèves, 72 enseignantes (ayant une moyenne de 18,5 années d’expérience en enseignement) et 49 intervenants scolaires (TES, orthopédagogues, psychologues, directions). Il a été structuré en trois temps : une collecte de données avant l’entrée dans le Lab-École, une seconde à l’arrivée et une troisième après l’implantation. Chaque école participante a reçu un rapport détaillé de ses propres résultats.
1. Processus d’acclimatation à un nouvel établissement scolaire
Les élèves et les enseignants ont vécu une période d’adaptation progressive aux nouveaux environnements scolaires (généralement composé de quatre étapes : adaptation, utilisation, appréciation, appropriation). Cette période d’acclimatation a permis une appropriation graduelle des lieux, facilitant l’intégration des nouvelles pratiques pédagogiques et sociales dans les espaces repensés. Un élément facilitant pour accélérer le processus est le soutien et l’accompagnement.
Recommandations :
- Consulter toutes les personnes qui occuperont les nouveaux espaces.
- Mettre en place des structures de collaboration et de partage (communautés de pratique, temps protégé pour la planification collective, réflexion commune pour le développement d’un langage et d’attentes communes)
- Mettre en place des structures d’accompagnement, comme du mentorat et des partenariats entre centres de services scolaires.
- Favoriser le leadership de la direction.
2. Les élèves : retombées sur leur réussite éducative et leur bien-être
La fréquentation d’un Lab-École est associée à une amélioration statistiquement significative de l’attitude des élèves envers l’école, de leur engagement scolaire ainsi que de leur perception de contrôle sur leurs apprentissages. Toutefois, une baisse temporaire de la capacité de concentration autorapportée a été observée après l’entrée dans ces nouveaux milieux. Ce recul initial s’estompe toutefois progressivement, à mesure que les élèves développent une meilleure connaissance d’eux-mêmes, une plus grande affirmation de soi, une responsabilisation accrue face à leurs apprentissages, ainsi qu’un rapport plus positif à l’erreur.
Recommandations :
- Accompagner les élèves par des pratiques qui favorisent leur autonomie.
- Déployer des approches pédagogiques efficaces qui soutiennent le développement des compétences socioémotionnelles dans une perspective holistique, incluant la créativité, les activités sportives collaboratives et l’intégration de ces dimensions au curriculum.
- Modéliser un rapport à l’erreur positif et constructif dans les pratiques enseignantes.
3. Saines habitudes de vie
Le niveau d’activité physique observé dans les Lab-École est comparable à celui des établissements québécois participant à la mesure « À l’école, on bouge! », bien qu’une grande variabilité soit constatée dans le temps sédentaire et les comportements actifs des élèves. Grâce à une plus grande permissivité du mouvement et à des espaces variés qui le facilitent, les élèves disposent de plus de choix pour bouger et développent une meilleure conscience de leurs besoins physiques.
Sur le plan de l’alimentation, les potagers scolaires offrent des occasions pédagogiques authentiques et constituent un levier d’interdisciplinarité. Un véritable écosystème alimentaire émerge autour de l’école, avec des retombées positives sur les habitudes alimentaires familiales. Les élèves y découvrent leurs goûts et intérêts personnels, qu’ils partagent ensuite. Dans une visée inclusive, ces initiatives permettent à tous les élèves d’avoir accès à des modèles positifs en matière de saine alimentation.
Recommandations :
- Favoriser une planification pédagogique intégrée aux espaces
- Assurer une appropriation progressive des espaces : exploration pédagogique, ateliers de coconception, accompagnement
- Varier les usages pédagogiques des espaces pour éviter la sédentarité
- Valoriser les espaces extérieurs dans l’offre pédagogique
- Évaluer en continu les usages et l’influence sur l’activité physique
4. Les enseignants : interactions, bien-être et efficacité personnelle
Les enseignants rapportent un meilleur bien-être psychologique et un sentiment accru d’efficacité personnelle dans la gestion de classe. Ils se sentent plus compétents individuellement et collectivement après leur arrivée au Lab-École. Les nouveaux environnements encouragent la collaboration et renforcent les pratiques pédagogiques centrées sur l’élève. Les enseignants perçoivent moins d’entraves à l’administration concernant l’innovation et développent une relation de confiance avec leur direction. Ils ont la perception que leurs besoins sont pris en compte dans la planification.
Recommandations :
- Accompagner la phase d’adaptation pour réduire le stress initial
- Soutenir l’appropriation progressive
- Améliorer l’utilisation des espaces
- Renforcer la confiance individuelle et collective par des pratiques collaboratives
- Capitaliser sur les forces de chacun
- Optimiser l’organisation de classe et l’engagement
- Investir dans un leadership pédagogique soutenant et cohérent
- Différencier l’accompagnement des enseignants par les directions
- Valoriser et entretenir la satisfaction professionnelle
- Pérenniser les conditions de succès
« Le modèle Lab-École pourrait constituer une approche prometteuse pour répondre aux défis de rétention du personnel enseignant, particulièrement dans un contexte où le gouvernement québécois doit renforcer ses stratégies pour recruter et garder les enseignants, notamment en améliorant les conditions de pratique. »
5. Curriculum : pédagogie et planification
Les enseignants des Lab-École ont été invités à concevoir et expérimenter des activités d’apprentissage à partir d’un modèle de planification adapté aux espaces scolaires innovants. Ils ont produit des fiches organisées par cycles, illustrant comment la flexibilité, la collaboration et l’ancrage dans la réalité des élèves peuvent enrichir les pratiques pédagogiques. L’analyse de vingt activités (sept en français, treize en mathématiques) révèle l’usage fréquent des gradins pour la lecture collective, des espaces extérieurs pour des mesures en grandeur réelle, ainsi que de lieux collaboratifs et de la cuisine. Ces activités rendent tangibles des notions abstraites et favorisent les liens avec la vie quotidienne, intégrant le mouvement et les espaces non traditionnels au service des apprentissages.
Recommandations :
- Adapter les moyens pédagogiques en différenciant les niveaux de difficulté, en variant les exercices et en formant des groupes selon les besoins spécifiques des élèves.
- Développer des outils d’évaluation comme des grilles d’autoévaluation et des traces écrites pour mieux suivre les apprentissages.
- Encourager la collaboration authentique, la communication entre pairs et la prise de risque pour développer les compétences socioémotionnelles.
- Planifier rigoureusement les activités en préparant le matériel, en organisant les espaces et en assurant la sécurité, surtout dans les lieux non traditionnels.
- Renforcer les liens avec la communauté en impliquant les parents, en diffusant les réalisations et en documentant les innovations pédagogiques.
6. Les intervenants : bien-être et sentiment d’efficacité personnelle
L’analyse des retombées pour les intervenants scolaires met en lumière une diminution du sentiment de jouer un rôle de soutien auprès de leurs collègues, ce qui reflète une baisse de l’efficacité collective perçue. Selon les chercheurs, cette tendance s’expliquerait par un manque d’accompagnement, de formation continue et par des espaces parfois inadaptés aux pratiques psychosociales. Effectivement, les contraintes liées à la confidentialité, notamment dans les espaces ouverts, limitent les interventions individuelles, en particulier pour les élèves à besoins particuliers. De plus, le potentiel des environnements innovants demeure sous-utilisé, en raison d’un besoin de formation et d’un apprentissage collectif encore en cours.
Malgré les défis de partage des lieux, les effets positifs de la lumière naturelle, de l’esthétique et des aménagements sur le bien-être, l’autonomie et la régulation des élèves – notamment ceux présentant un TDAH – sont largement reconnus.
Recommandations :
- Implanter des espaces de rencontre formels et informels dédiés aux intervenant·es.
- Développer un programme de formation continue sur l’utilisation pédagogique des espaces innovants.
- Créer des zones modulables permettant la confidentialité pour les interventions psychosociales.
- Créer des communautés de pratique pour favoriser le partage d’expériences et d’innovation dans les pratiques psychosociales dans ces nouveaux environnements scolaires.
- Développer des stratégies d’aménagement et d’intervention différenciées selon les besoins (TDAH, troubles du comportement, etc.).
7. Architecture et collaboration école-famille-communauté
Les résultats démontrent que les nouveaux espaces d’apprentissage des Lab-École répondent aux objectifs de polyvalence pour lesquels ils ont été conçus, mais que leur appropriation par les enseignants demeure un processus complexe. Ce processus dépend de divers facteurs tels que l’architecture (proximité, mobilier, qualité des lieux), les caractéristiques individuelles des enseignants (intérêts, objectifs, capacité d’adaptation) et les dynamiques sociales au sein de l’équipe-école. Certains conflits d’usages peuvent limiter la mutualisation des espaces, mais des règles collectives et des habitudes partagées permettent de les surmonter efficacement. Par ailleurs, la collaboration entre enseignants est facilitée par des espaces pensés pour le travail coopératif et par un état d’esprit proactif au sein des équipes.
Recommandations :
- Impliquer l’ensemble des acteurs de la communauté éducative – y compris les parents – dès la programmation du bâtiment et pendant toute la durée des phases de conception, de chantier et d’exploitation, afin d’identifier des problèmes d’usages susceptibles de se poser et élaborer collectivement des réponses à y apporter.
- Envisager une amélioration continue des Lab-École et capitaliser sur l’expérience de ces bâtiments dans les détails les plus fin de la conception, en lien avec des situations de vie quotidienne problématiques.
- Accompagner les enseignants dans l’appropriation des espaces et l’adaptation de leurs pratiques.
8. Espaces extérieurs
Les enseignants disposent de plusieurs espaces extérieurs, mais leur utilisation varie grandement selon leur aisance et leur niveau de préparation. Si les disciplines comme le français, les mathématiques et les sciences sont les plus souvent mobilisées, l’interdisciplinarité demeure rare. Les espaces extérieurs sont fréquemment utilisés comme simple prolongement de la classe, plutôt que comme lieux pleinement investis pour soutenir les apprentissages. Le développement d’une pédagogie en plein air est perçu comme un processus progressif nécessitant du temps, de la planification et du soutien. La gestion des comportements, la sécurité et le manque de temps figurent parmi les principaux défis, bien que les enseignants manifestent une volonté claire de développer leurs compétences en ce domaine.
Recommandations :
- Offrir de la formation et de l’accompagnement sur les fondements de l’éducation en plein air pour établir des repères communs.
- Proposer un soutien personnalisé sur la gestion de classe et la gestion des risques en fonction des contextes scolaires.
- Offrir des expériences d’accompagnement adaptées aux réalités locales pour exploiter les atouts des espaces extérieurs en toutes saisons.
- Créer des espaces-temps pour permettre aux enseignants de planifier, collaborer et identifier leurs besoins en développement professionnel.
- Développer une plateforme collaborative en ligne pour favoriser le partage de pratiques et de ressources pédagogiques.
Recommandations générales pour construire l’école de demain
À la lumière de ces constats, de façon globale, les chercheurs identifient les mots-clés suivants pour l’avenir de l’école : formation, accompagnement, coconstruction et collaboration.
Ils recommandent de :
- Miser sur le développement des capacités adaptatives et des compétences socioémotionnelles, essentielles au 21ᵉ siècle.
- Soutenir l’innovation pédagogique en misant sur le potentiel de l’environnement physique.
- Valoriser la formation continue participative et collaborative comme levier d’amélioration des pratiques.
- Promouvoir une gouvernance collaborative et participative à tous les niveaux du système éducatif.
- Encourager la coconstruction et la collaboration entre chercheurs et milieux scolaires pour nourrir une culture de la recherche sur le terrain.
- Capitaliser sur l’intelligence collective générée dans les communautés éducatives pour faire évoluer les approches pédagogiques.
Ce rapport se veut à la fois un bilan des retombées des Lab-École et une base de réflexion pour concevoir, habiter et faire évoluer les milieux scolaires de demain.