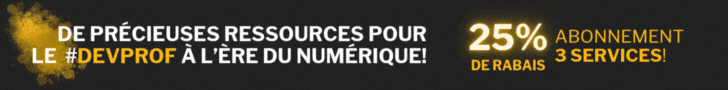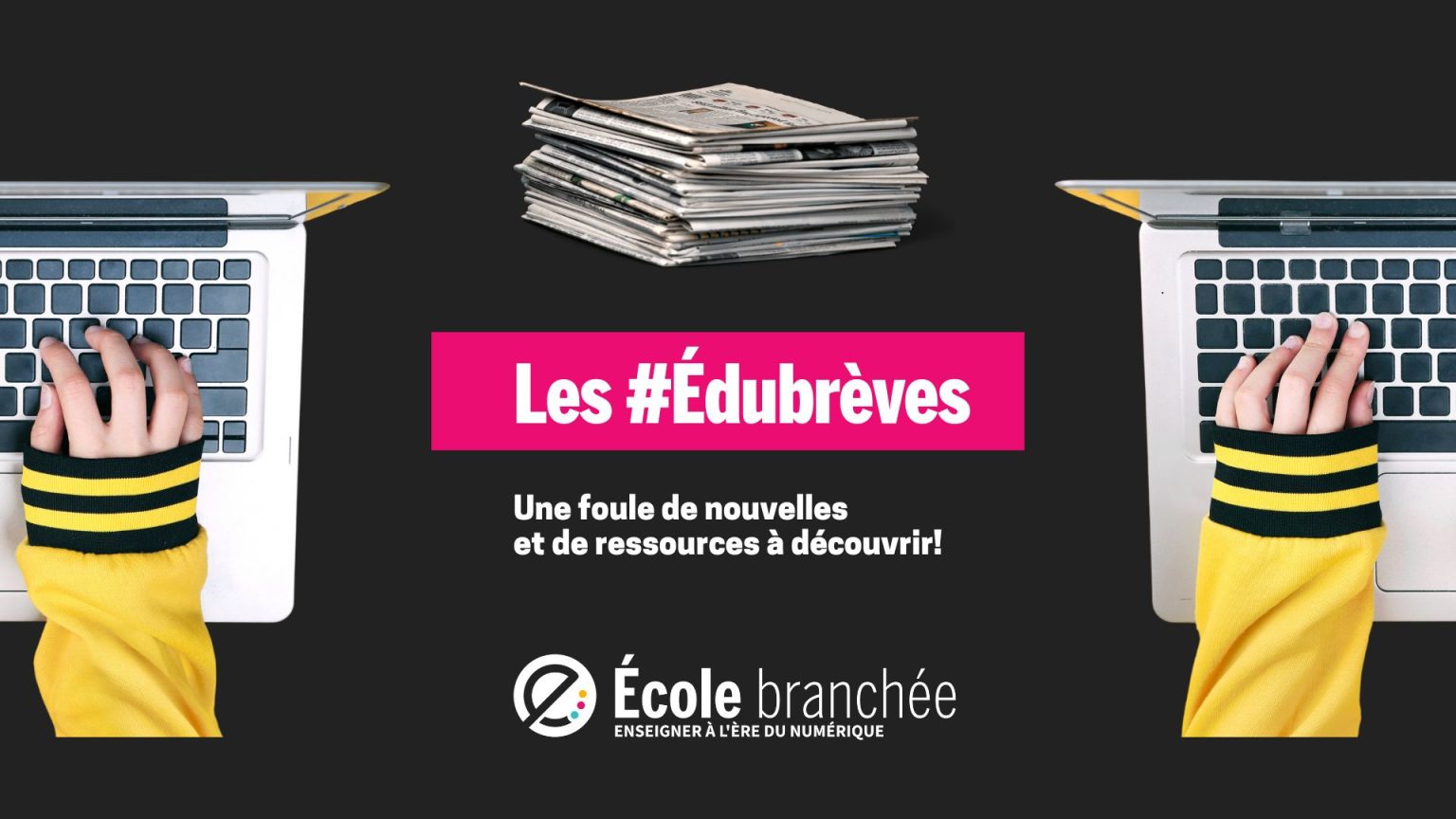Par Marc-André Girard, directeur d’établissement scolaire et collaborateur de l’École branchée
Lors de la journée Init-IA-tive, tenue en janvier 2025 à Laval, au Québec, et axée sur les répercussions de l’intelligence artificielle (IA) en contexte scolaire, la professeure Margarida Romero a pris la parole à titre de conférencière invitée. Dans son intervention matinale, elle a souligné que l’usage des IA exige des humains qu’ils mobilisent leur subjectivité, leur intuition, leur sens moral et leur capacité d’adaptation. Cette position soulève une question fondamentale : remet-elle en cause le discours dominant qui, à l’ère du Big Data et des données probantes, valorise l’objectivité dans la prise de décision en éducation?
En apparence, plusieurs systèmes scolaires, guidés par une logique de gestion axée sur les résultats, cherchent à exploiter toutes les données disponibles pour prendre des décisions les plus objectives possible. C’est dans ce cadre que l’intelligence artificielle (IA) est perçue comme un levier prometteur pour soutenir la réussite scolaire. Les IA dites « prédictives » sont désormais capables d’anticiper le parcours d’un élève, y compris les risques de décrochage, en croisant des données scolaires, familiales et socioéconomiques. Elles produisent ainsi un diagnostic instantané : à partir des données actuelles, voici ce que l’avenir scolaire réserve.
Or, ces prédictions ne sont pas figées. Elles peuvent — et doivent — évoluer, car si l’IA prédit, c’est l’humain qui agit. Une fois le signal d’alerte lancé, les professionnels de l’éducation doivent travailler en collaboration avec les parents pour élaborer des pistes de solution. C’est à ce moment précis que l’intervention de Margarida Romero prend tout son sens, et ce, à deux niveaux.
Premièrement, une nouvelle entité s’ajoute à la collaboration entre les professionnels de l’école et les parents : l’IA. Grâce à la coopération humain-machine, cette dernière permet d’exploiter les données en profondeur afin de réduire les angles morts propres aux humains, qui ne disposent ni de la puissance de calcul ni du temps requis pour effectuer de telles analyses fondées sur les trajectoires scolaires.
Deuxièmement, une fois l’analyse objective effectuée par la machine et interprétée par ceux qui connaissent bien l’élève, l’humain doit observer ce que Pasi Sahlberg appelle les « minidonnées ». Contrairement à l’économie, le système éducatif repose sur des éléments humains qui exigent de maximiser les traits relationnels pour bien saisir la réalité quotidienne des écoles. Au-delà des mégadonnées (Big Data), il y a les Small Data, ces données fortement contextualisées, issues des observations faites par le personnel scolaire auprès des élèves : une élève qui ne mange pas à sa faim, un autre affecté par une peine d’amour, une qui porte constamment les mêmes vêtements souillés, ou encore un élève qui ne se présente pas aux périodes de récupération. Ces informations, bien que cruciales, échappent aux algorithmes. Et si les IA permettent de réduire certains angles morts des équipes-écoles, elles possèdent elles-mêmes des zones d’ombre.
Les données sont disponibles, les IA les analysent et peuvent prédire des tendances. Toutefois, la prise de décisions éclairées, fondée sur l’objectivité des données, demeure une responsabilité humaine, dans une visée de réussite pour tous les élèves. L’humain mobilise alors son intuition, enrichie par les informations livrées par l’IA, pour confronter ce qu’il observe sur le terrain aux données analysées. C’est donc le grand retour du « pif » des membres des équipes-écoles, mais cette fois appuyé par des outils permettant de valider ce flair et de cibler précisément les interventions à effectuer. Le « comment » restera toujours entre les mains de l’humain, guidé par son autonomie professionnelle et son jugement éclairé.
L’intelligence artificielle en éducation ne rime donc pas avec déshumanisation, bien au contraire ! Il s’agit d’une cohabitation harmonieuse entre objectivité et subjectivité. Les données analysées par la machine permettent à l’humain de mettre en valeur son humanisme et d’influencer positivement la réussite scolaire. Le subjectif des acteurs de terrain trouve désormais un sens et une valeur : celle d’augmenter l’humain au bénéfice des citoyens de demain.