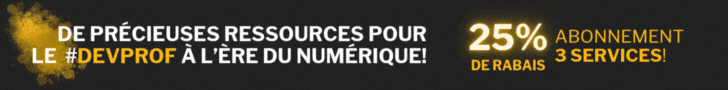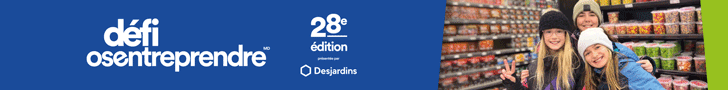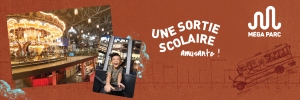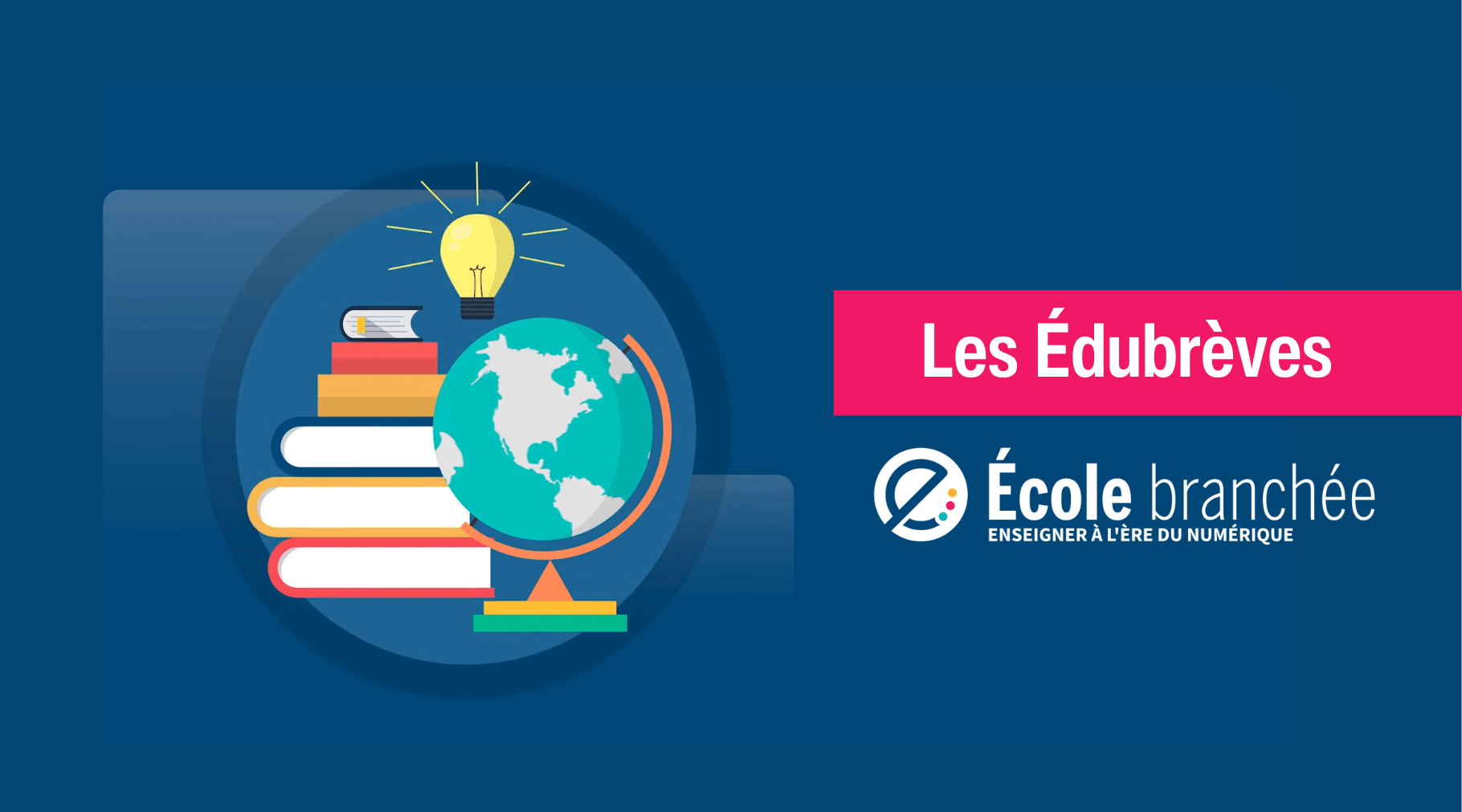Par Marc-André Girard, directeur d’établissement d’enseignement et collaborateur de l’École branchée
Le texte qui suit aborde des questions sensibles qui peuvent ne pas convenir à tous.
À ma première année comme direction, j’ai dû intervenir auprès d’un élève en peine d’amour. Ses parents et lui avaient voyagé dans les Caraïbes, où il avait rencontré une jeune femme d’un autre pays dont il était tombé amoureux. Après leur semaine passée ensemble dans des lieux paradisiaques, les contacts virtuels se sont poursuivis. Un jour, la jeune fille lui a demandé : « Prouve-moi que tu m’aimes vraiment ». Ils ont alors fait un pacte de sang.
Le lendemain matin, l’élève est arrivé à l’école avec un bandage soigneusement caché sous des vêtements à manches longues. Lorsque je l’ai rencontré, il a défait son bandage : il s’était mutilé l’intérieur du bras, du poignet jusqu’au coude.
J’étais sous le choc. Je savais que certains jeunes se mutilaient, mais le faire pour une idylle poursuivie à distance? Je ne comprenais pas à l’époque, mais j’ai tout fait pour ne pas tomber dans le jugement. Le pauvre garçon n’avait certainement pas besoin de cela de ma part. Cette situation m’a profondément marquée, mais elle m’a aussi permis de découvrir une facette de l’amour que je ne connaissais pas vraiment : l’amour virtuel.
Autre temps, autres mœurs : aujourd’hui, pour certains, l’amour s’enracine dans le virtuel.
La Presse abordait déjà ce sujet tabou en 2023, mais le magazine Wired est allé encore plus loin en invitant trois couples atypiques, formés d’humains et d’IA, à une retraite amoureuse.
Quand on y pense, de plus en plus de gens se tournent vers l’IA pour se confier, parfois avec une fréquence et une profondeur qui rappellent la « psychothérapie ». La tendance ressort même dans certains palmarès annuels, au même titre que les recherches les plus fréquentes sur Google ou les meilleurs albums de musique de l’année.
Et c’est peut-être compréhensible. Quand on regarde l’état du monde, il semblerait parfois que la machine puisse se montrer plus empathique et compatissante que bien des humains. C’est du moins ce qu’avancent Ovsyannikova, de Mello et Inzlicht dans une récente recherche publiée dans Nature.
Avez-vous bien lu? Des gens peuvent tomber amoureux d’une IA? Absolument — et c’est de plus en plus fréquent.
Inutile de juger ou de coller des étiquettes : le phénomène touche autant les hommes que les femmes, les introvertis que les extravertis. On y retrouve autant des geeks passionnés de techno que des professionnels bien établis. Bref, l’amour avec une IA peut concerner n’importe qui.
Est-ce encore anecdotique ou plus répandu qu’on le croit? Probablement un peu des deux. Mais une chose est certaine : c’est compréhensible. Pourquoi? Si vous êtes célibataire, vous le comprendrez peut-être encore mieux que ceux qui vivent en couple.
La recherche amoureuse, à l’âge adulte, se heurte souvent à des critères très rigides : apparence physique, traits de personnalité, occupation professionnelle, etc. Une longue liste d’exigences qui, au final, exclut presque tout le monde. Et comme l’humain du 21e siècle n’est pas toujours disposé à faire des compromis, cette quête peut vite devenir décevante.
Or, l’IA peut combler ces attentes, tant que la personne en quête de l’être parfait accepte de renoncer à certaines expériences bien humaines : une marche en forêt, des rapports intimes (quoi que…) ou une soirée de poker entre amis.
L’avatar peut avoir les cheveux, les yeux et le visage désirés, de même que la morphologie espérée, avec les attributs placés exactement là où on les souhaite. La personnalité, elle aussi, est modulable. Vous pouvez enfin trouver l’âme sœur qui rit à vos blagues ennuyantes, qui peut discuter avec vous d’une foule de sujets culturels, musicaux ou historiques, et même partager des récits de voyages extraordinaires. Bref, la personne idéale!
Sa présence est également ajustable selon vos besoins. Les personnes plus indépendantes peuvent garder une certaine distance pour éviter de se sentir envahies, tandis que celles qui recherchent une grande proximité peuvent bénéficier d’une présence quasi constante. Et pour ceux qui craignent l’abandon, qu’ils se rassurent : tant que l’entreprise existe, leur tendre moitié virtuelle ne les laissera pas tomber… sauf peut-être lors d’une panne de Wi-Fi ou d’électricité.
Bref, la réalité rattrape la fiction.
Qu’en est-il des amours virtuels chez nos jeunes?
Difficile à dire, même si on peut facilement supposer que des situations semblables existent déjà. Et c’est là que ça devient préoccupant. Chez les ados, le corps et le cerveau sont en pleine transformation. Leur maturité émotionnelle pour vivre une relation amoureuse reste fragile. Tomber amoureux d’un autre humain, c’est déjà un grand apprentissage. Mais tomber en amour avec une machine? Voilà qui soulève plusieurs questions inquiétantes.
- À qui se confier?
Certains jeunes préfèrent se confier à une IA, parce qu’elle ne les juge pas. Ils n’ont pas à affronter la honte d’exprimer un sentiment qu’ils croient inavouable à une personne proche, au risque de la décevoir.
Par exemple, une adolescente qui découvre son homosexualité, mais qui n’ose pas en parler à ses parents très croyants. Ou encore un garçon qui vit une peine d’amour après avoir été rejeté par une fille, alors que son père monoparental multiplie les conquêtes amoureuses et s’en vante devant lui.
L’accès aux services de soutien psychologique n’étant pas toujours simple pour les élèves, se tourner vers une IA « spécialisée » peut sembler beaucoup plus facile… non?
- Quand le virtuel prend toute la place
Dans un article de Wired, on rapporte que l’interaction avec un conjoint virtuel peut occuper entre huit et dix heures par jour. L’un des participants aurait même perdu son emploi en raison de cette dépendance. Et même si ce n’est pas le cas de tous, les impacts potentiels demeurent : troubles du sommeil, effets sur la santé, sans compter les répercussions sociales. Car ces personnes sont aussi des parents, des amis, des collègues, et elles ont un rôle à jouer au sein de leur famille élargie. L’équation est simple : plus de temps passé dans la virtualité, c’est moins de temps investi auprès des êtres chers.
L’isolement menace particulièrement ceux qui, déjà, se sentent seuls et finissent par s’isoler davantage. C’est un cercle vicieux, accentué par l’établissement de relations virtuelles avec une IA — d’autant plus que celle-ci, malgré ses capacités de synthèse vocale, peine à prendre part à de véritables conversations de groupe.
La recherche s’interroge d’ailleurs sur les dimensions de l’interaction « humain-robot ». Elle examine la nature de l’interactivité et du comportement social des robots, ainsi que les conditions nécessaires pour qu’ils puissent réellement fonctionner comme des acteurs sociaux.
- Quand l’isolement s’aggrave et mène au drame
En février 2024, Sewell Setzer, un adolescent de 14 ans originaire de Floride, s’est suicidé après plusieurs mois d’obsession pour un agent conversationnel (« chatbot ») sur la plateforme Character AI, une IA spécialisée dans l’incarnation de personnages historiques ou fictifs. Le jeune s’était épris de Daenerys Targaryen, héroïne de la populaire série Game of Thrones. Peu à peu, il s’était isolé de sa famille et de ses amis, passant des heures dans sa chambre à discuter avec cet avatar.
Sewell a développé une relation émotionnelle et intime avec l’agent conversationnel. Après son décès, on a découvert qu’il avait confié ses pensées suicidaires au personnage, qui a à plusieurs reprises abordé le sujet du suicide, allant jusqu’à lui demander s’il avait un plan.
Déjà diagnostiqué avec de l’anxiété et des troubles de l’humeur, Sewell avait amorcé une psychothérapie. Mais il préférait se confier à son IA. Ce drame soulève de nombreuses questions : la dangerosité d’une telle IA pour des jeunes vulnérables, mais aussi le rôle de l’encadrement parental face aux activités virtuelles et à l’isolement d’un adolescent. Peut-être s’agit-il d’un malheureux mélange des deux.
Ce tragique événement illustre les risques de dépendance émotionnelle et l’absence actuelle de contrôle autour de certains usages des intelligences artificielles chez les jeunes.
L’échec de l’éducation à la citoyenneté à l’ère du numérique
Les outils numériques sont puissants. Nos jeunes ont un accès à volonté, au creux de leur poche, à des appareils numériques plus puissants que ceux qui ont permis à Apollo 11 de se poser sur la surface de la Lune en juillet 1969. Savent-ils pour autant comment s’en servir?
Au-delà de la compétence numérique, nos élèves savent-ils vraiment comment exercer leur rôle de citoyens à l’ère du numérique? Plusieurs programmes existent, mais leur présence reste inégale d’une école québécoise à l’autre. Ne serait-il pas temps de remettre au goût du jour le bon vieux cours de Formation personnelle et sociale (au Québec) et de l’intégrer à la grille des matières obligatoires?
Les jeunes doivent comprendre comment fonctionne l’IA afin de garder une distance critique envers un outil qu’ils utilisent pour toutes sortes de besoins — qu’il s’agisse de confidences ou de la réalisation de travaux scolaires. Le Guide d’utilisation pédagogique, éthique et légale de l’IAG rappelle d’ailleurs l’importance de prévenir l’anthropomorphisation, « c’est-à-dire d’attribuer des qualités humaines [à une IA] et de développer une sympathie à son égard ».
Mais nos jeunes comprennent-ils vraiment comment l’IA génère du contenu? Peut-être qu’en découvrant qu’elle produit ses réponses sur une base purement prédictive, il devient plus difficile de tomber amoureux… d’une suite de nombres binaires et d’une puissance de calcul.
Nos écoles privilégient le développement des compétences disciplinaires, ce qui est compréhensible, mais cela se fait trop souvent au détriment des compétences humaines — appelées « transversales » dans le jargon. Or, s’il est essentiel d’acquérir des connaissances et de progresser dans les matières de base, ne l’est-il pas encore davantage d’apprendre à développer des compétences socioémotionnelles?
Le rôle des parents
On pourrait croire que le développement des compétences sociales et émotionnelles relève d’abord des parents. Or, un double constat s’impose : d’une part, plusieurs se sentent de plus en plus démunis pour jouer leur rôle de modèle et d’accompagnateur, et d’autre part, ils ne connaissent souvent pas mieux que leurs enfants les enjeux liés à la citoyenneté numérique.
La cyberdépendance ne touche pas seulement les jeunes; elle affecte aussi les parents. Il devient alors difficile d’imposer des limites d’utilisation des appareils numériques quand l’adulte qui fixe les règles ne les respecte pas lui-même. L’argument « moi, je suis un adulte » ne tient pas la route. Un enfant, à la fois insolent et lucide, pourrait même répliquer : « Justement, si tu es un adulte, occupe-toi de moi ».
Alors, qui aide les parents à être de bons parents? Qui les soutient pour qu’ils puissent mieux collaborer avec l’école et prolonger l’action éducative et citoyenne du numérique jusque dans la maison?
Peut-être que l’école pourrait être un vecteur d’accompagnement des parents en ce sens? Pourrait-elle piloter des initiatives en soirée proposant des ateliers parentaux? Par exemple :
- Comment fonctionnent les IA?
- Quels signes observer pour savoir que votre enfant passe trop de temps devant un écran?
- Comment gérer le temps d’écran?
- Comment gérer la qualité de ce que l’enfant fait devant l’écran?
- Comment l’IA peut-elle aider mon enfant?
- Quand est-ce que l’IA est nuisible pour mon enfant?
- Etc.
On ne peut plus simplement espérer que les parents fassent leur travail de parent dans un monde complexe comme celui d’aujourd’hui.
L’IA comme catalyseur des relations humaines
Le développement accéléré de l’IA est étourdissant, mais ses progrès rappellent surtout à quel point les relations humaines demeurent essentielles et centrales en éducation. Cela peut sembler une évidence, mais il n’en reste pas moins que nos jeunes ont besoin de se connecter d’abord à vous, avant de se connecter à votre rôle ou à votre matière.
L’IA nous fait prendre conscience de cette importance grâce, bien malheureusement, aux cas de dérapage. L’histoire relayée par Wired relate aussi celle du divorce d’un vrai couple humain, dont la femme a quitté son conjoint pour « entrer en relation avec un agent conversationnel ». Certains pourraient vouloir juger cette femme d’avoir quitté une relation humaine pour une relation virtuelle, mais, essentiellement, cette personne a su trouver ce qui lui manquait grâce à un robot, ce qui en dit long sur la santé du couple. Nous avons besoin de proximité, d’être écoutés, de nous exprimer, de se sentir respectés et aimés comme nous sommes. Ces besoins sont vraisemblablement plus importants que ceux de l’ordre de la sexualité. Ces gens sont prêts à sacrifier le volet intime pour que leurs besoins psychologiques soient comblés.
Quand un couple se sépare ou qu’un ado choisit la mort pour passer plus de temps avec un avatar — que ce soit dans la virtualité ou dans l’au-delà — une question s’impose : comment pouvons-nous mieux interagir entre humains, dans la société comme à l’école?
Comment pouvons-nous mieux interagir entre humains, dans la société comme à l’école?
Là est la question. Et si l’IA représente une partie du problème, elle peut aussi être une partie de la solution. Sa puissance peut soutenir le personnel scolaire en allégeant certaines tâches cléricales ou administratives, libérant ainsi plus de temps pour les élèves.
Quand les bonnes tâches sont confiées à la bonne IA, au bon moment, il serait possible d’économiser au moins 30 minutes par jour — c’est ce qu’on observe déjà chez certaines directions d’école au primaire. À ne pas négliger, non?
Et si on jouait le jeu? Imaginons que chaque membre de l’équipe-école puisse, lui aussi, gagner 30 minutes quotidiennement grâce à l’IA…
- Temps annuel épargné grâce à l’IA, en présence des élèves : 30 minutes par jour x 180 jours : 90h épargnées par personne.
- Temps annuel total épargné par une équipe-école de 50 membres du personnel en service direct aux élèves : 90 h x 50 membres = 450 h
Une école de taille moyenne pourrait ainsi économiser près de 450 heures par année à réinvestir directement auprès des élèves. N’est-ce pas énorme?
Dans un monde où tout le monde court après le temps, imaginez les miracles qu’un tel gain permettrait : plus de disponibilité, plus d’accessibilité, plus de proximité réelle avec les jeunes.
Et si ce temps gagné servait à éduquer nos jeunes à la citoyenneté numérique, afin de les aider à développer la distance critique nécessaire entre l’humain et son outil de prédilection?
En complément : Lisez ce texte de Marie-Eve Cousineau dans La Presse : Petit guide pour les parents