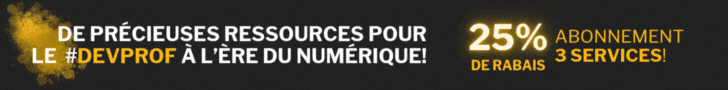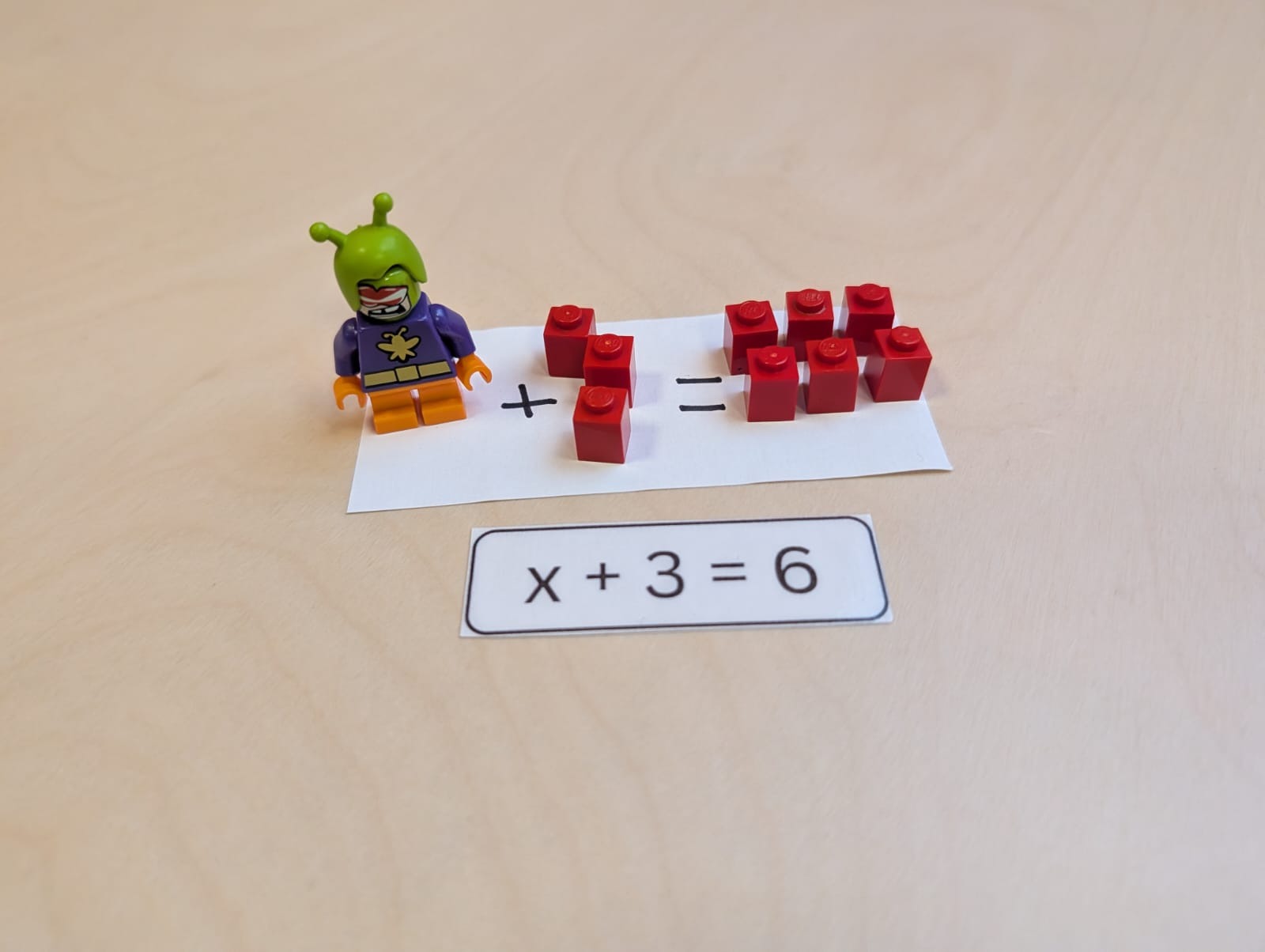Par École branchée
Cet article est un résumé de 6 Things We’re Getting Wrong About Tech Integration, paru sur le site Edutopia.
Lorsque les écoles ont fermé en 2020, la technologie est soudainement devenue l’unique planche de salut. Mais le virage rapide vers les plateformes numériques ne s’est pas fait sans conséquences. Le nombre d’outils technologiques mis à la disposition du personnel et des élèves s’est multiplié et leur pertinence n’a pas toujours été bien évaluée.
Une fois la pandémie passée, il aurait fallu se demander : quels logiciels avaient réellement une valeur pour soutenir l’apprentissage et méritaient d’être conservés, et lesquels relevaient plutôt des mesures d’urgence et pouvaient être abandonnés? Des années plus tard, trop d’écoles ne se sont pas encore posé ces questions et se retrouvent avec un arsenal d’outils technologiques attrayants… mais à l’utilité discutable. Selon un sondage américain, en moyenne, seulement la moitié des outils disponibles sont utilisés chaque mois.
Un sondage national mené auprès de 8 500 directions d’établissement et enseignants aux États-Unis révèle que, si 87 % des directions d’école jugent l’usage efficace des technologies essentiel à leur mission, seulement 18 % considèrent que leurs enseignants sont très compétents pour les intégrer efficacement en classe.
Les obstacles identifiés sont nombreux : soutien technique peu fiable (72 %), manque d’occasions de développement professionnel (52 %), ou encore absence de stratégies pour gérer une classe remplie d’appareils numériques (42 %).
L’équipe d’Edutopia a rencontré des experts en éducation qui ont partagé les erreurs les plus fréquentes lorsqu’il est question de favoriser l’intégration du numérique à l’école ainsi que des pistes pour y remédier.
1. Des logiciels… sans soutien
Beaucoup de districts investissent dans des outils et des plateformes sans prévoir le temps ni le budget nécessaires pour les tester adéquatement et pour former le personnel. « Le manque d’investissement dans la formation fait que les écoles n’obtiennent pas de retour sur leur investissement, puisque les enseignants n’utilisent pas les outils », explique Michelle Manning, spécialiste en intégration technopédagogique.
Une période d’intégration, jumelée à des occasions régulières de développement professionnel et à des suivis pour recueillir des rétroactions (ou simplement des retours), est essentielle. La formation peut aussi prendre la forme de courts tutoriels vidéo que les enseignants peuvent consulter à leur rythme ou d’ateliers en classe où l’enseignant et les élèves découvrent un nouvel outil ensemble.
2. Des décisions d’achat en vase clos
Ne pas impliquer les bonnes personnes dès le départ dans l’achat de matériel ou de logiciels peut coûter cher. Réunir le personnel pédagogique et l’équipe des technologies de l’information autour de la même table est déterminant, même si cela peut générer des tensions au départ.
La mise en place d’un comité de sélection numérique peut permettre d’évaluer chaque outil en fonction de son coût, de sa fréquence d’utilisation et de sa pertinence pédagogique, tout en assurant un alignement sur les objectifs éducatifs et budgétaires.
3. La technologie pour la technologie
Durant la pandémie, l’adoption massive de tous types d’outils est devenue la norme. Aujourd’hui, on constate que, parfois, la technologie est utilisée même lorsqu’elle n’apporte pas de réelle valeur ajoutée. Sans lignes directrices claires, les enseignants se retrouvent souvent à devoir décider seuls quand et comment l’intégrer.
Un processus de décision collaboratif aide à uniformiser les pratiques et à éviter la surutilisation d’outils simplement « attrayants ».
Kathi Kersznowski, spécialiste en technologie éducative, propose trois questions pour guider les choix :
- Quel est l’objectif?
- Que voulez-vous que vos élèves apprennent?
- Comment voulez-vous qu’ils vous démontrent leurs apprentissages?
Les réponses ne conduiront pas toujours à l’utilisation d’un outil numérique.
4. Des outils sans règles
L’intégration des technologies échoue souvent lorsque les écoles les déploient sans établir au préalable des attentes claires et des routines efficaces. Avant que les élèves n’utilisent un appareil, il faut que la gestion de classe définisse quand, comment et pourquoi l’utiliser. Sans ces balises, les distractions prennent rapidement le dessus.
Il est ainsi essentiel de préciser les règles d’utilisation, les soins à apporter aux appareils et les conséquences en cas de non-respect. De plus, l’expérience utilisateur doit être pensée du point de vue de l’élève : un accès trop complexe aux ressources numériques entraîne frustration et perte de temps. Une structure claire et prévisible favorise non seulement la bonne utilisation des outils, mais aussi l’efficacité pédagogique de la technologie en classe.
5. Des appareils inutilisés, des élèves non préparés
De plus en plus perçus comme des sources de distraction, ordinateurs portables, tablettes et appareils Chromebook sont parfois mis de côté. Certains enseignants trouvent le papier plus efficace pour certaines activités. Pourtant, bannir complètement la technologie peut accentuer la fracture numérique que l’école cherche à réduire. Moins on utilise les appareils, moins les élèves apprennent à s’en servir à bon escient.
Il est prouvé que les compétences numériques avancées ne s’acquièrent pas automatiquement. Les élèves ont besoin d’un accompagnement structuré et l’école a un rôle à jouer en ce sens.
6. Consommation plutôt que création
En dehors de l’école, les élèves produisent activement du contenu numérique. En classe, cette créativité est souvent remplacée par un usage passif : visionner des vidéos, remplir des documents ou répondre à des questionnaires en ligne.
Miser sur le potentiel créatif des élèves signifie leur offrir des occasions de produire des affiches, des livres numériques, des balados ou des animations pour démontrer leurs apprentissages. De nombreuses plateformes peuvent devenir de puissants leviers pour favoriser cette expression créative.
En résumé, une intégration technologique réussie repose moins sur la quantité d’outils que sur la qualité de leur utilisation, l’alignement avec les objectifs pédagogiques, le soutien continu offert aux enseignants et la mise en place de règles claires pour les élèves. Passer de la simple consommation à la création et à la maîtrise réfléchie des outils, voilà la voie qui permet de redonner tout son sens à l’investissement technologique en éducation.