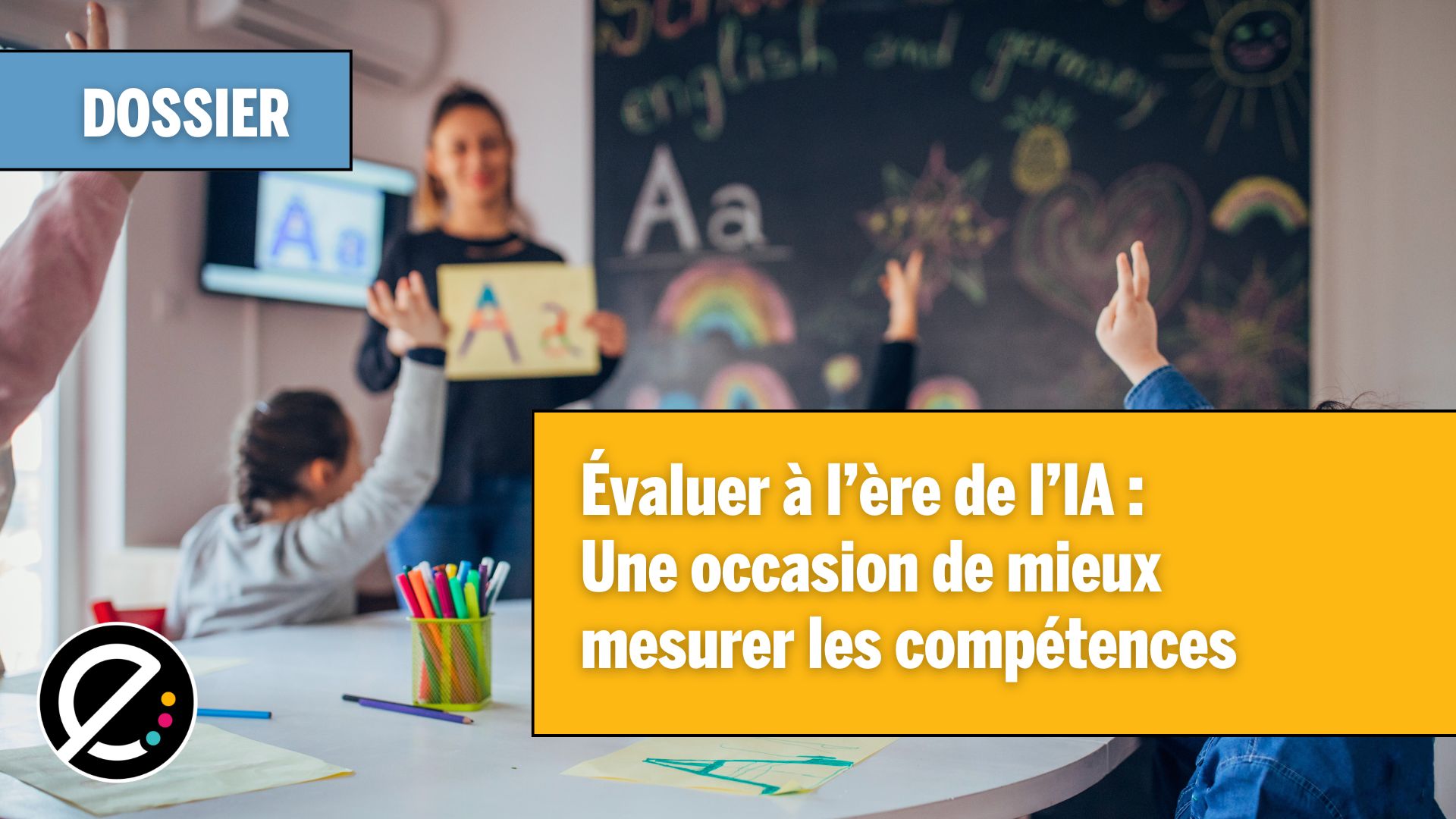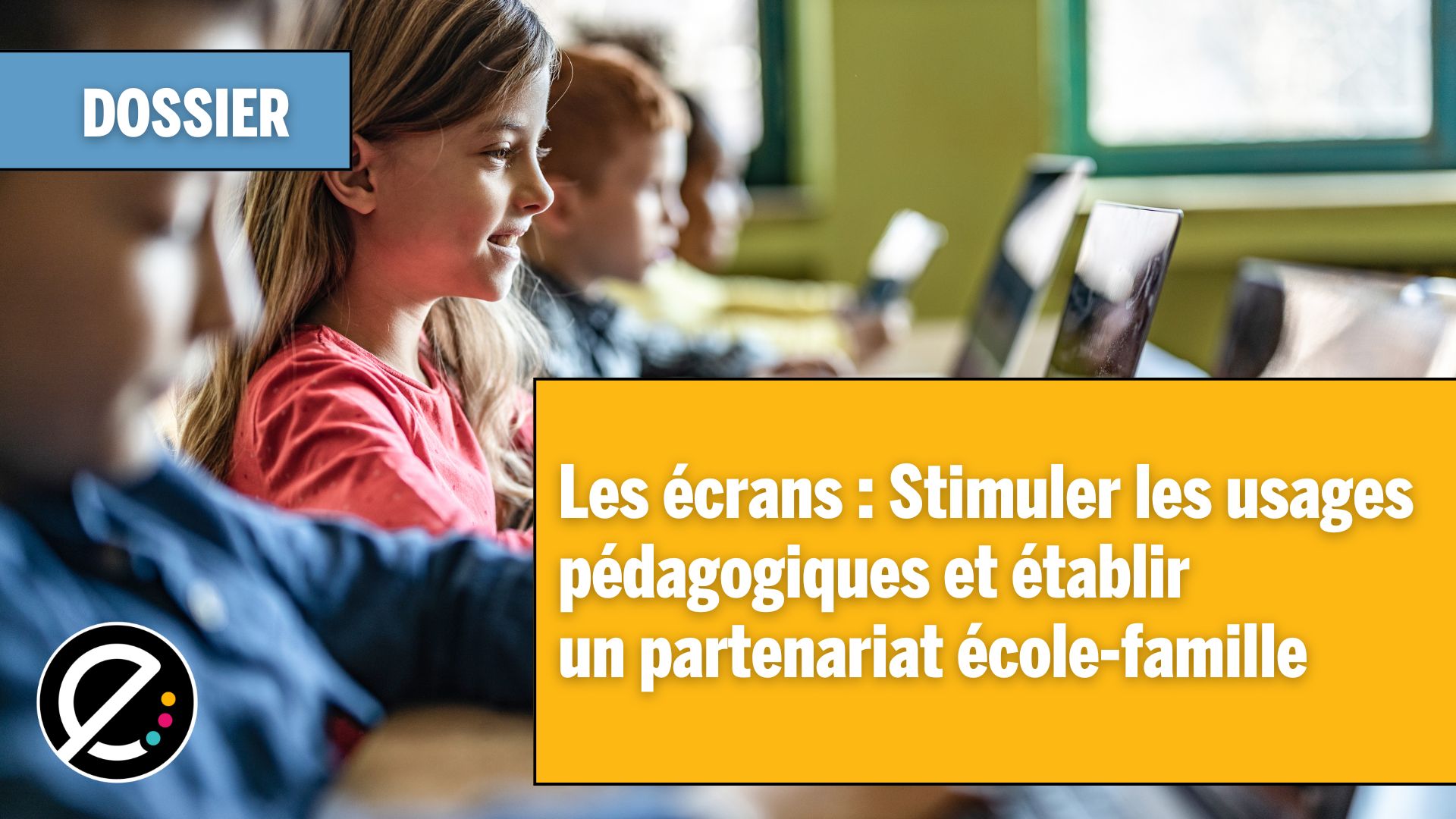(suite du dossier)
Autrefois, les jeunes ayant des troubles d’apprentissage étaient simplement considérés comme faibles. Aujourd’hui, on comprend mieux leurs difficultés et on tente davantage de leur donner un coup de pouce. Services de professionnels, outils technologiques, temps supplémentaire ou local séparé pour compléter un examen sont des options offertes de plus en plus souvent.
L’impression d’iniquité envers les autres élèves persiste toutefois chez certains acteurs du milieu de l’éducation. Nadia Rousseau, psychopédagogue et professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’a noté dans le cadre d’une recherche-action. « Ce que nous avons constaté au départ, c’est que les enseignants connaissaient peu les technologies. Les craintes étaient très élevées, indiquait la chercheuse à Infobourg l’an dernier. La perception était que les technologies d’aide rendaient la vie pas mal facile aux jeunes qui en bénéficiaient et que c’était injuste pour les autres. Certains enseignants se demandaient s’il n’était pas préférable que ces élèves fréquentent des classes d’adaptation scolaire. »
D’ailleurs, chaque rentrée, la mère de Derrick, Marie-Josée Brunelle, se bute à des réticences. Elle doit parfois rencontrer certains enseignants et elle ne parvient pas toujours à les convaincre.
Il faut défaire ces préjugés coriaces en faisant réaliser que les aides technologiques n’avantagent pas un tel élève, mais contribuent plutôt à le mettre à niveau, croit Richard Ayotte, conseiller pédagogique en intégration des TIC et personne-ressource RÉCIT à la commission scolaire des Samares. « J’ai en tête un élève qui venait d’avoir un premier succès scolaire avec l’utilisation de ses outils d’aide. On lui a dit : “C’est comme si tu avais triché, tu ne toucheras plus à ça!”.»
Paradoxalement, les capacités intellectuelles élevées de certains jeunes sont parfois un désavantage. Ils arrivent à compenser leurs difficultés et ils décrochent néanmoins la note de passage. « Un élève va obtenir 65 %, mais il pourrait avoir 85 % et plus avec l’aide d’un logiciel de synthèse vocale, explique Jean-Louis Tousignant, président du conseil d’administration de l’Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA). Mais comme il n’est pas en échec, certaines directions d’école refusent de mettre en place un plan d’intervention. » Or, des résultats faibles peuvent empêcher l’admission du jeune dans un programme particulier et compromettre la poursuite de ses études.
« Il ne faut pas confondre la justice avec l’égalité, nuançait Jean Chouinard, conseiller pédagogique à la Commission scolaire de Montréal et personne ressource au Service national du RÉCIT en adaptation scolaire dans une entrevue en 2011. Il faut penser davantage en terme d’équité; tout le monde n’est pas pareil. Je compare souvent l’aide technologique avec une paire de lunettes : tout le monde n’en a pas besoin, mais elles sont indispensables pour ceux qui les portent. D’un autre côté, toutes les lunettes n’ont pas la même force et s’ajustent avec le temps. C’est la même chose pour l’aide technologique, elle doit être adaptée pour ceux qui en ont besoin, dans une logique d’équité. »
La Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l’information et des communications en éducation fait valoir que les aides technologiques ne font pas le travail à la place de l’élève. « Le logiciel oblige l’élève à réfléchir. C’est comme s’il avait un enseignant à ses côtés qui le questionnait constamment », illustre-t-il.
Ce qu’en disent les autorités
La Politique d’évaluation des apprentissages, adoptée par le ministère de l’Éducation en 2003, est claire quant aux principes qui doivent guider les enseignants. « À cause de l’importance de l’évaluation dans la vie scolaire de l’élève, il est nécessaire qu’elle soit faite dans le respect des valeurs qui en assurent la qualité, écrit-on. Alors que la justice implique que les droits des élèves sont reconnus et respectés par l’application des lois et règlements qui les régissent, l’égalité suppose que les jugements portés sur les apprentissages sont basés sur des références et des critères uniformes. Quant à l’équité, elle implique la prise en compte de caractéristiques individuelles, ou communes à des groupes, afin d’éviter d’avantager indûment certains élèves ou de causer des préjudices à d’autres. »
Le ministère insiste également sur le respect des différences. « Les élèves ont des capacités et des façons d’apprendre différentes; ils n’évoluent pas tous au même rythme ni de la même manière. Des différences découlent aussi des caractéristiques socioéconomiques et culturelles de leurs milieux d’origine. Tenir compte de ces différences suppose que l’enseignant a recours à la différenciation pédagogique qui permet aux élèves de développer les compétences exigées tout en empruntant des voies diverses et qu’il ajuste en conséquence ses méthodes d’évaluation des apprentissages. En cours d’apprentissage, l’enseignant prévoit des situations qui sont communes à tous les élèves d’un groupe et d’autres qui sont différenciées pour tenir compte du rythme de progression ou des besoins particuliers de certains. Pour l’évaluation aux fins de la reconnaissance des compétences, le respect des différences suppose l’adaptation des modalités d’évaluation aux particularités de certains élèves, sans que les exigences de réussite ne soient modifiées. »
Par ailleurs, les contraintes budgétaires ne sont plus une excuse pour refuser des services à ces élèves, rappelle Jean-Louis Tousignant. En effet, dans un jugement rendu en novembre, la Cour suprême du Canada a indiqué que « des services d’éducation spécialisés adéquats ne sont pas un luxe dont la société peut se passer ». Dans cette cause très médiatisée, des parents d’un garçon dyslexique poursuivait le gouvernement de la Colombie-Britannique en raison de l’abolition d’un programme orthopédagogie intensive à l’école qu’il fréquentait.
SOMMAIRE DU DOSSIER :
Introduction
1. Connaître enfin le succès grâce à la technologie
2. Des TIC pour aider les élèves ayant des troubles d’apprentissage : une injustice pour les autres?
3. Technologies d’aide aux troubles d’apprentissage : le défi technopédagogique des enseignants
4. Numériser son matériel traditionnel : guide de survie
5. Déploiement d’aides technologiques : des changements à prévoir dans la classe
6. Technologies d’aide et évaluation ministérielle
Conclusion