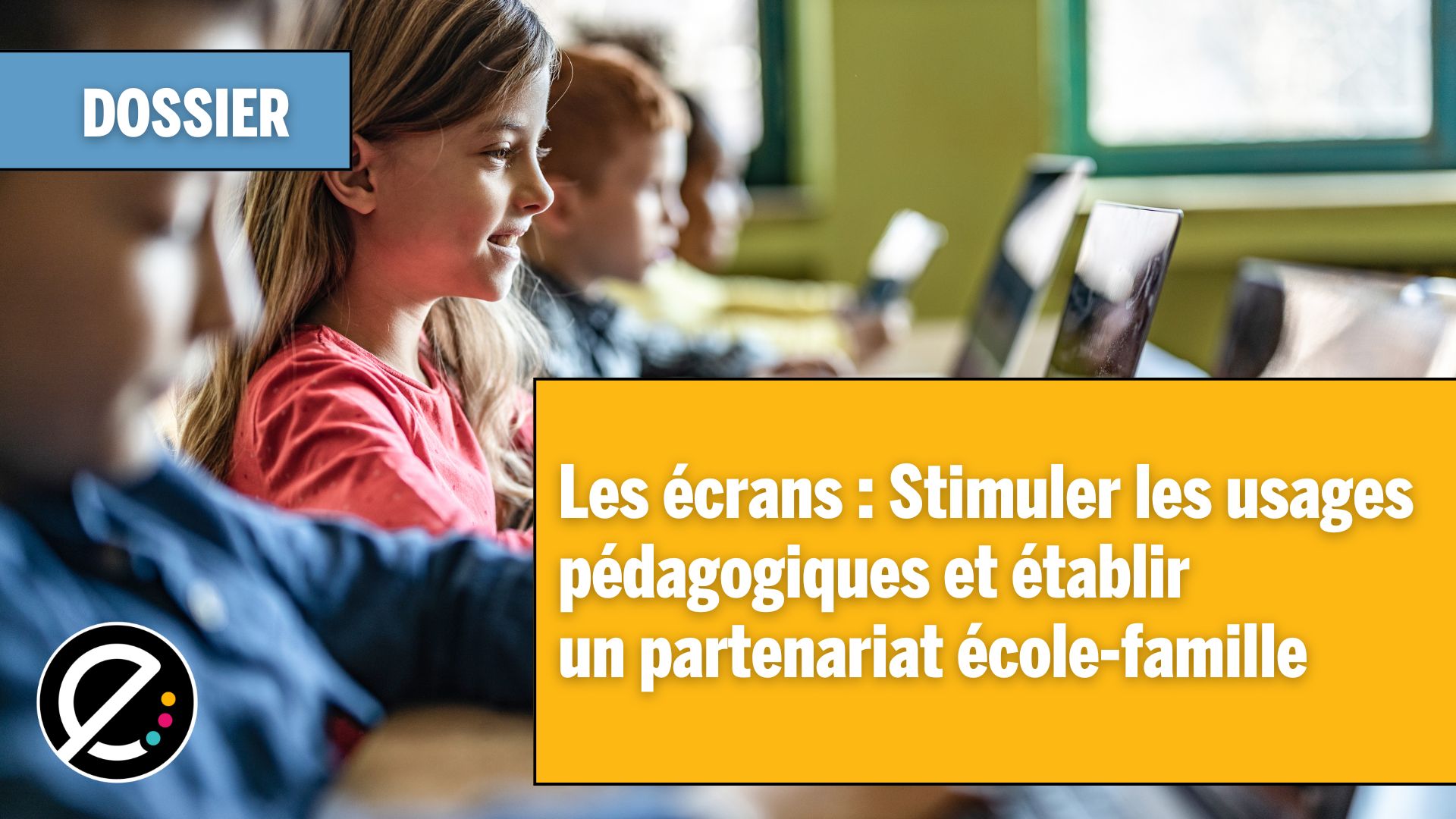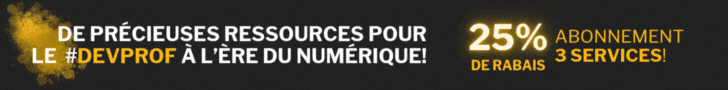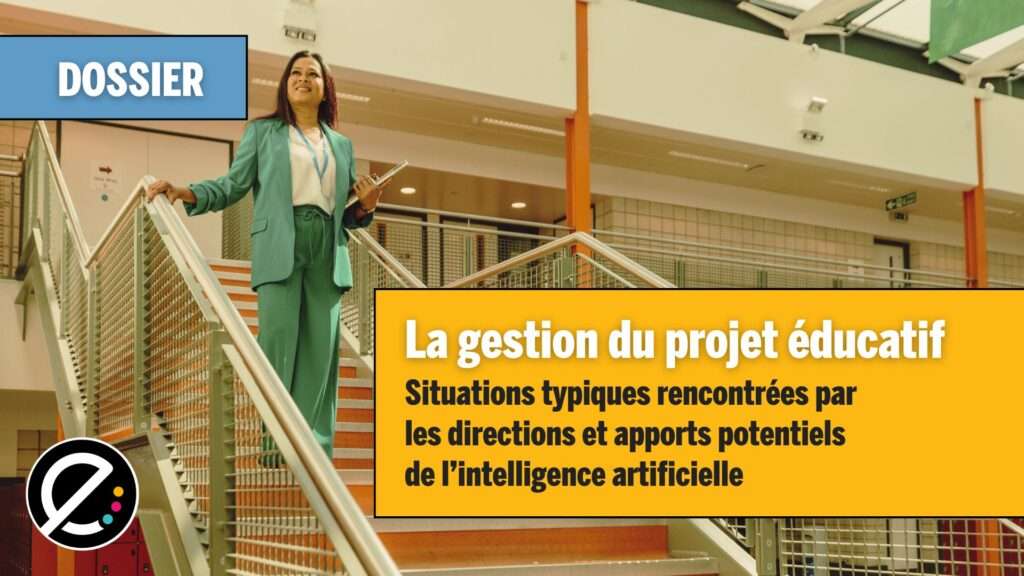Par Judicaël Alladatin, professeur à l’Université de Montréal, spécialiste de la gouvernance et de la planification de l’éducation, et Bianka Bessette, directrice d’établissement scolaire et doctorante en administration de l’éducation à l’Université de Montréal*
Au Québec, les directions d’établissement d’enseignement jouent un rôle central dans le pilotage du projet éducatif, un outil stratégique de planification inscrit dans le cadre normatif défini par la Loi sur l’instruction publique (LIP).
Le projet éducatif élaboré en cohérence avec le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) du centre de services scolaire, doit également s’arrimer aux grandes orientations du plan stratégique du ministère de l’Éducation (MEQ) (Villeneuve & Bouchamma, 2024; Gouvernement du Québec, 2022). Il vise à soutenir la réussite éducative de tous les élèves en dotant chaque école de ses propres orientations, priorités d’action et résultats attendus en fonction des besoins de ses élèves et des attentes de sa communauté.
Dans la réalité quotidienne des établissements d’enseignement, le pilotage du projet éducatif requiert un équilibre délicat entre le respect des prescriptions institutionnelles, l’exercice d’une autonomie locale encadrée et l’adaptation continue à des enjeux contextuels de plus en plus différenciés : diversité linguistique et culturelle, inclusion des élèves à besoins particuliers, attentes accrues en matière de résultats, climat scolaire, personnel non légalement qualifié, etc.
Ce contexte impose à la direction d’établissement des arbitrages et des prises de décisions stratégiques, car il ne s’agit pas seulement d’assurer une conformité aux normes ou de suivre des prescriptions et un échéancier préétabli, mais de faire évoluer l’organisation éducative, de construire du sens et de mobiliser des acteurs aux intérêts parfois divergents autour d’une vision commune et d’objectifs partagés.
Or, le travail des directions est encore parfois perçu à travers une grille administrative, éclipsant la finesse des dynamiques d’action qui le traversent (Lapointe et Langlois, 2004).
Comment les directions d’école vivent-elles alors la gestion du projet éducatif et en quoi l’intelligence artificielle peut-elle devenir un levier pertinent pour soutenir cette responsabilité stratégique, sans dénaturer le rôle éducatif et humain de la direction?
Pour tenter de répondre à cette question, nous mobilisons la notion de situation typique, entendue comme un scénario récurrent et significatif dans lequel les directions d’établissement d’enseignement déploient des stratégies, ajustent leurs pratiques et négocient les contraintes propres à leur milieu (Perrenoud, 2004; Barrère, 2006).
Une situation typique, dans une perspective professionnelle, constitue une unité d’analyse pertinente de l’activité réelle, en ce qu’elle mobilise des compétences à la fois techniques, relationnelles et organisationnelles (Mayen, 2012). Repérer ces situations permet non seulement de mieux comprendre le travail de pilotage tel qu’il se déploie au-delà des prescriptions normatives, mais aussi de soutenir la professionnalisation, l’accompagnement et l’amélioration continue des pratiques (Flandin et Ria, 2014; Poizat et San Martin, 2020; Yvon et al., 2022).
Un double regard sur le pilotage du projet éducatif
Dans cet article, nous adoptons un double regard pour analyser quelques situations typiques au cœur du pilotage du projet éducatif : celui d’une direction d’école expérimentée et engagée dans la conduite effective de projets éducatifs depuis une quinzaine d’années ainsi que celui d’un chercheur en gouvernance et planification de l’éducation, observateur des transformations contemporaines de l’administration de l’éducation et de la complexité de la gestion du projet éducatif dans divers contextes francophones.
Ensemble, les auteurs identifient quelques situations typiques significatives issues de leurs expériences, puis les analysent de manière réflexive afin de mettre en lumière les compétences et postures professionnelles susceptibles de favoriser une gestion efficace du projet éducatif. Ils proposent ensuite une réflexion sur les apports potentiels de l’intelligence artificielle (IA) dans la gestion du projet éducatif. Leur objectif est d’ouvrir un espace de réflexion nuancée sur la manière dont les outils algorithmiques pourraient, sans se substituer à la délibération humaine, soutenir la prise de décision des directions d’école, notamment en matière d’interprétation des données, de priorisation des actions ou de visualisation des progrès.
Regard réflexif sur quelques situations typiques de gestion du projet éducatif
La gestion du projet éducatif se structure autour de trois moments clés :
- son élaboration (diagnostic, priorisation, mobilisation),
- sa mise en œuvre (planification opérationnelle, mobilisation des ressources, accompagnement),
- son suivi-évaluation (lecture des données, régulation, reddition de comptes).
À chacune de ces étapes, les directions d’école sont confrontées à des situations récurrentes, mais complexes, que sont désignées ici comme des situations typiques. Issues du regard croisé entre praticien et chercheur, ces situations ne prétendent pas couvrir toute la réalité de la gestion du projet éducatif, mais proposent une première lecture structurante de certains défis récurrents, susceptibles d’enrichir l’analyse, d’orienter la formation et de guider l’action.
Élaborer un projet éducatif dans un contexte de diversité
Parmi les situations qui retiennent l’attention figure celle de la conception du projet éducatif dans un contexte marqué par une diversité linguistique, culturelle et socioéconomique. Dans plusieurs écoles québécoises, les équipes doivent composer avec des réalités très hétérogènes, ce qui complexifie non seulement le repérage des besoins prioritaires, mais aussi l’adhésion à une vision commune parmi des acteurs aux référentiels et attentes parfois divergentes.
En effet, plusieurs élèves ont des besoins particuliers en raison, par exemple, de troubles de l’apprentissage, de troubles du spectre de l’autisme et de déficiences intellectuelles ou physiques. Les écoles accueillent aussi un nombre croissant d’élèves issus de l’immigration qui parfois ne maitrisent pas la langue d’enseignement. La diversité des profils d’apprentissage ainsi que les écarts entre les élèves de milieux favorisés et défavorisés amènent une complexité à cerner les besoins prioritaires au sein d’un établissement scolaire surtout dans un contexte où les membres du personnel et du conseil d’établissement qui participent à l’élaboration du projet éducatif portent des valeurs et des visions différentes.
L’élaboration du projet éducatif exige alors une écoute du milieu, une capacité d’analyse fine du contexte et un leadership inclusif permettant de fédérer les acteurs autour d’orientations mobilisatrices.
Les données issues du milieu (résultats, portraits sociodémographiques, consultations) deviennent des leviers pour éclairer le choix d’orientations et favoriser la collaboration de l’équipe-école et de la communauté. Le leadership nécessaire s’appuie sur la capacité à faire émerger un sens collectif à partir d’une pluralité de besoins et de référentiels (Leithwood, Harris, et Hopkins, 2020) et à traduire cette vision dans des actions cohérentes avec le déploiement des ressources dans le milieu.
Ce travail requiert aussi une ouverture à l’adaptation continue, au fil des transformations du contexte et de la dynamique organisationnelle, ce qui se traduit par une constante évolution du plan d’action et des pratiques à mettre en place.
Mobiliser une équipe dans un contexte de fatigue organisationnelle
Un second type de situation, particulièrement observable dans la phase de mise en œuvre, est celui de la mobilisation d’équipes pédagogiques fragilisées par l’accumulation des réformes, des contraintes structurelles ou des crises.
À titre d’exemple, au cours de la dernière année scolaire, certaines équipes-écoles ont vu leur clientèle augmenter considérablement et se diversifier, notamment en raison de l’ajout de nouveaux espaces, ce qui a parfois entraîné des déménagements de locaux. Parallèlement, la mise en œuvre du nouveau programme CCQ a exigé des formations supplémentaires, alors que la pénurie de personnel oblige les équipes à effectuer des heures supplémentaires ou à répondre aux besoins des élèves avec des ressources limitées.
Cette fatigue organisationnelle peut se manifester par une démobilisation progressive, une baisse de l’initiative, voire un repli sur les tâches et responsabilités. Dans un tel contexte, la dynamique collective s’essouffle, affaiblissant la portée mobilisatrice du projet éducatif. Le leadership requis dans ces moments n’est pas directif, mais transformationnel, centré sur la relance du sens, la reconnaissance des efforts et la reconstruction d’un climat propice à l’engagement (Day, Gu, et Sammons, 2020). Ce type de leadership s’inscrit dans une temporalité longue, exigeant constance, écoute et patience.
Loin des injonctions descendantes, la mobilisation durable s’appuie sur une redéfinition partagée des priorités, une gestion sensible du rythme de travail et des alliances internes structurantes. La direction peut, dans cette perspective, maintenir la mobilisation de l’équipe en valorisant les efforts et en célébrant collectivement de petits gains, même modestes.
Le projet éducatif peut alors devenir un levier, à condition qu’il soit discuté à nouveau, adapté au contexte et porteur d’un horizon réaliste. La direction doit rester focalisée sur les objectifs stratégiques et la réussite des élèves, tout en adaptant de manière continue le plan d’action aux réalités changeantes du milieu scolaire (régulation).
Opérationnaliser les priorités institutionnelles sans dénaturer le projet local
Cette situation typique renvoie à la tension entre les enjeux spécifiques des milieux locaux et les priorités institutionnelles définies à différents niveaux, notamment le plan stratégique du ministère de l’Éducation et le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) des centres de services scolaires.
Dans certains cas, cette dynamique peut conduire les directions à appliquer de manière mécanique les lignes directrices, au risque d’éroder le sens du projet éducatif qui doit être à l’image du milieu.
Certaines directions d’école, au contraire, endossent un rôle actif de médiation et de traduction entre les exigences systémiques et les réalités du terrain. Cela exige une compétence de traduction organisationnelle ou de réinterprétation locale des politiques éducatives (Spillane, Parise, et Sherer, 2019), permettant de contextualiser les objectifs sans altérer l’identité de l’établissement.
Dans cet esprit, le principe de subsidiarité, au cœur du pilotage éducatif au Québec, suppose que les décisions soient prises au niveau le plus proche de l’action, afin de répondre aux besoins réels des communautés scolaires.
Ce travail de réinterprétation stratégique repose sur des arbitrages éclairés, une communication transparente avec les parties prenantes et la mobilisation de l’intelligence collective pour donner sens et légitimité aux choix opérés. Il incarne une forme de leadership réflexif, capable de conjuguer rigueur institutionnelle et ancrage local.
Pour y parvenir, la direction doit posséder à la fois une compréhension fine des exigences organisationnelles et une connaissance approfondie du contexte propre à l’établissement. Cela souligne l’importance de s’appuyer sur les données disponibles dans le milieu et de mener des consultations auprès des élèves, du personnel, des parents et de la communauté afin d’orienter les actions de manière éclairée.
Ajuster les actions en fonction de données parfois partielles, éparses ou ambivalentes
Dans la phase de suivi-évaluation, les directions d’établissement scolaire sont fréquemment confrontées à utiliser des données fragmentées, issues de systèmes d’information diversifiés et parfois incomplètes. Cette complexité rend l’interprétation difficile et exige des compétences en littératie des données, c’est-à-dire à la fois des capacités techniques d’analyse et une aptitude à la mise en contexte critique (Mandinach et Gummer, 2016).
Dans ce cadre, un tableau de bord équilibré, construit à partir des priorités spécifiques du milieu, peut constituer un outil structurant. Il permet de centraliser et de croiser divers types d’indicateurs (quantitatifs et qualitatifs) tout en favorisant une lecture globale des dynamiques en jeu.
Cependant, comme le rappellent Spillane, Reiser et Reimer (2002), l’interprétation des données est aussi une opération de traduction organisationnelle. Elle suppose en effet de donner sens à des informations hétérogènes dans un contexte local donné, en tenant compte des contraintes et des référentiels d’action. Cela appelle à éviter la tentation de survaloriser certains indicateurs, à reconnaître les limites des modèles d’évaluation linéaires, et à préserver une posture réflexive face à la complexité des environnements scolaires.
Donner du sens aux indicateurs pour éclairer la régulation
L’effort d’interprétation globale des divers indicateurs constitue une autre situation typique à laquelle les directions scolaires sont confrontées dans le pilotage du projet éducatif. Qu’il s’agisse de taux de réussite, d’absentéisme, de perceptions parentales ou d’indicateurs de climat scolaire, ces données, loin d’être de simples outils de mesure, deviennent des objets de discussion, de négociation et parfois de tension au sein de l’équipe-école.
Leur interprétation mobilise des cadres de référence variés. Dans cette perspective, la direction scolaire assume un rôle de médiation interprétative. Elle doit articuler les différents regards portés sur les données afin d’en dégager des points d’ancrage partagés pour guider la régulation pédagogique et organisationnelle.
À cet effet, la mise en place d’une salle de pilotage (Thériault et Tremblay, 2022) peut représenter un levier structurant. En favorisant un accès centralisé, collaboratif et visuel aux données clés, la salle de pilotage soutient une lecture partagée et dynamique de l’évolution des indicateurs. Couplée à l’utilisation d’un tableau de bord équilibré (Kaplan et Norton, 1992; Alladatin et Gnanguenon, 2025), elle peut permettre d’enrichir l’analyse, de mieux contextualiser les écarts observés et de prévenir une focalisation excessive sur certains indicateurs au détriment d’autres.
Ce dispositif appelle des compétences en littératie des données, non seulement sur le plan technique, mais aussi critique et contextuel (Mandinach et Gummer, 2016). Cela suppose une posture réflexive continue et une vigilance face aux risques de surinterprétation, de réduction des indicateurs à des prescriptions normatives ou de leur instrumentalisation.
Lorsque cet équilibre est trouvé, l’interprétation des données devient un véritable levier de pilotage collectif et de développement professionnel au service de la réussite éducative et contribue à maintenir une articulation féconde entre amélioration continue et stabilité organisationnelle (Harris, Jones et Adams, 2021).
Conciliation entre exigences administratives et pilotage pédagogique
Une situation typique transversale, susceptible d’influencer toutes les phases du cycle de pilotage, est celle de l’articulation entre les exigences administratives et l’engagement dans le pilotage pédagogique.
Plusieurs travaux de recherche évoquent une surcharge du travail des directions d’établissement d’enseignement, éclaté entre l’animation pédagogique, la gestion des ressources, les obligations administratives et les relations avec les partenaires du milieu (Alladatin et Soumanou, 2024 ; Barrère, 2006). Cette dispersion des tâches peut affaiblir la capacité des directions scolaires à assumer pleinement leur rôle pédagogique. Pourtant, ce qui est le plus efficace pour réduire le taux d’échec scolaire est l’implication directe des leaders scolaires dans la pédagogie et dans le suivi des résultats des élèves (Collerette et al., 2013).
Face à cette réalité, la notion de leadership équilibré constitue un cadre d’action pertinent (Leithwood et al., 2020). Elle invite à conjuguer, de manière soutenable, les responsabilités institutionnelles avec les exigences du pilotage pédagogique et de l’accompagnement des apprentissages. Cela suppose de développer une capacité à planifier rigoureusement, à mobiliser des outils de gestion du temps, à déléguer intelligemment, à prioriser les actions en fonction de leur valeur éducative ajoutée et à mobiliser de manière stratégique les outils numériques ainsi que les ressources humaines, afin de réduire la charge administrative pour préserver un espace réel pour l’exercice du leadership pédagogique et du travail réflexif.
Réflexion sur les défis actuels et les tensions persistantes de la gestion du projet éducatif
Les situations typiques précédemment décrites sont révélatrices des tensions constitutives de la gestion du projet éducatif. Elles nécessitent d’être reconnues, mieux étudiées et comprises pour être régulées de manière continue. Elles se situent à l’intersection de plusieurs logiques (institutionnelle, professionnelle, pédagogique, communautaire) que les directions doivent sans cesse articuler, souvent dans un climat de pression temporelle, émotionnelle et politique.
1- Prescription et autonomie professionnelle
La première tension identifiée, oppose prescription et autonomie professionnelle. Le cadre normatif québécois, en particulier depuis la mise en place des centres de services scolaires et la réaffirmation des responsabilités de pilotage local, confère aux directions une marge d’initiative stratégique. Toutefois, cette autonomie est constamment encadrée par des attentes institutionnelles fortes : arrimage du projet éducatif avec le plan stratégique et le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), reddition de comptes, respect des politiques ministérielles.
Ce paradoxe d’autonomie prescrite oblige les directions à négocier en permanence entre le respect de cadres imposés et la liberté d’adapter les orientations aux réalités de terrain (Lapointe et Langlois, 2004).
2- Performance mesurable et engagement éthique
Une seconde tension oppose performance mesurable et engagement éthique. Le pilotage du projet éducatif repose sur une culture de la donnée de plus en plus affirmée : indicateurs de réussite, taux de diplomation, résultats aux examens ministériels, etc. Si ces données peuvent être des leviers précieux d’amélioration, elles ne doivent pas masquer les finalités plus profondes de l’éducation.
La réussite ne peut se résumer à des chiffres, elle doit porter aussi une attention à certaines dimensions souvent absentes des tableaux de bord officiels.
Les directions doivent en effet veiller à préserver un regard global sur les élèves, incluant leur bien-être, leur engagement et leur développement socio-affectif. Cette tension appelle une posture de leadership éthique, capable de résister à une vision technocratique de l’éducation et de porter une attention aux finalités humanistes du projet scolaire (Day, Gu, et Sammons, 2020).
L’engagement éthique suppose également de donner du sens aux données chiffrées pour les enseignants, afin qu’elles ne soient pas perçues comme une source de malaise ou de pression. Il est important qu’ils ne se sentent ni injustement évalués ni sanctionnés par l’application de critères de performance trop rigides.
Ainsi, les directions d’école ont la responsabilité de traduire les orientations managériales en actions pédagogiques concrètes, accessibles et mobilisatrices pour l’ensemble du personnel (Savard et al., 2024).
3- Accès aux données et capacité d’analyse
Une troisième tension concerne l’accès à une masse croissante de données (données ministérielles, évaluations locales, retours d’enseignants, enquêtes de climat scolaire, etc.) et les capacités réelles d’analyse dont disposent les directions.
Or, les outils institutionnels d’aide à la décision restent souvent fragmentaires et la formation à la littératie des données demeure inégalement déployée. Les directions se situent au cœur de la prise de décision fondée sur les données, mais leur formation et leur expérience sont principalement ancrées en pédagogie et en administration de l’éducation, ce qui peut constituer un obstacle pour transformer les données en connaissances utiles et en actions concrètes. Ce décalage entre l’exigence d’un pilotage fondé sur les données et la réalité des pratiques renforce le sentiment d’isolement stratégique ressenti par certaines directions (Mandinach et Gummer, 2016).
4- Collaboration humaine et surcharge numérique
Enfin, une quatrième tension émerge entre collaboration humaine et surcharge numérique. L’intégration progressive d’outils numériques dans la gestion scolaire promet des gains de temps, une meilleure circulation de l’information et des appuis à la planification. Cependant, dans la pratique, ces outils peuvent aussi générer une forme d’aliénation : multiplication des plateformes, redondance des rapports, notifications constantes, etc.
Le risque est que les directions consacrent davantage de temps à alimenter des systèmes qu’à dialoguer avec leur milieu. Il devient alors crucial de distinguer les outils qui soutiennent réellement le travail collaboratif de ceux qui l’entravent (Harris, Jones, et Adams, 2021).
Quel potentiel alors pour l’intelligence artificielle dans la gestion du projet éducatif?
Les transformations numériques ont un impact sur l’ensemble des sphères de l’action éducative. Parmi elles, l’intelligence artificielle (IA) suscite un intérêt croissant dans le monde scolaire. Si les débats se concentrent souvent sur ses usages pédagogiques (assistants d’apprentissage, corrections automatisées, tutorats intelligents), ses applications dans le champ de la gouvernance scolaire, et plus précisément dans le pilotage du projet éducatif, demeurent encore peu explorées.
Les études se sont majoritairement penchées sur les défis et les risques liés à l’adoption de l’intelligence artificielle en éducation, même si plusieurs travaux ont également exploré les opportunités et les bénéfices qu’elle peut offrir (Tahiru, 2021). Pourtant, les besoins sont réels puisque la gestion du projet éducatif repose sur des tâches complexes et chronophages : collecte et lecture des données, planification stratégique, identification des priorités, suivi de la mise en œuvre et régulation continue.
Le recours à l’intelligence artificielle pour la gestion du projet éducatif pourrait permettre d’automatiser les tâches administratives répétitives, de mieux anticiper les évolutions à venir et de dégager du temps précieux pour que les directions puissent se concentrer sur des enjeux stratégiques (Al-Omari, 2024).
Un levier d’aide à la décision
Dans ce contexte, l’IA pourrait constituer un levier d’aide à la décision, à condition d’être pensée comme un outil au service de l’autonomie professionnelle et non comme un substitut à la réflexion humaine.
Il semble alors que plusieurs usages potentiels de l’IA peuvent être envisagés dans le cadre du pilotage du projet éducatif :
- L’automatisation de tableaux de bord dynamiques : grâce à l’IA, il serait possible de croiser automatiquement plusieurs sources de données (résultats scolaires, absences, climat, engagement des élèves, etc.) pour générer des visualisations personnalisées, évolutives et compréhensibles. Par exemple, certaines analyses d’apprentissage permettent de prédire quels élèves sont à risque d’échec. Ces outils pourraient aider les directions à dégager des tendances, à repérer des écarts significatifs et à orienter rapidement leurs plans d’action.
- L’identification d’alertes précoces : des modèles prédictifs pourraient permettre de repérer des signes de désengagement scolaire ou de détérioration du climat de classe, sur la base de données longitudinales anonymisées. Cela offrirait aux directions une capacité d’intervention plus rapide et mieux ciblée.
- Le soutien à la priorisation stratégique : face à la diversité des objectifs possibles dans un projet éducatif (réussite en lecture, bien-être, inclusion, persévérance, etc.), des systèmes intelligents pourraient suggérer des regroupements cohérents d’actions, en fonction des ressources disponibles, des contraintes identifiées et des résultats passés. Ces suggestions ne remplaceraient pas la délibération collective, mais pourraient faciliter la planification initiale.
- L’assistance à la régulation en continu : en analysant l’évolution des indicateurs en temps réel, une IA pourrait générer des propositions d’ajustement ou des scénarios alternatifs pour renforcer la mise en œuvre des plans d’action de la réussite. Cette fonction serait particulièrement utile pour les directions ayant peu de soutien administratif.
- La génération d’outils de collecte de données et de diffusion : l’IA générative pourrait permettre aux directions d’école de gagner un temps considérable dans leurs tâches quotidiennes en générant des sondages dynamiques à envoyer aux parents, aux élèves ou au personnel, puis en compilant les réponses en tableaux et diagrammes interactifs prêts à l’analyse. Elle pourrait aussi produire des dépliants visuels ou des infographies à partir des données recueillies, facilitant ainsi la diffusion des résultats ou des priorités du projet éducatif. Ces outils sont personnalisables, faciles à mettre à jour et permettent de centraliser l’information sans passer par des processus manuels longs et répétitifs.
Un allié discret, mais puissant
Ces potentialités, bien que prometteuses, ne peuvent être mobilisées sans un encadrement rigoureux. D’abord, l’intégration de l’IA en milieu scolaire doit respecter l’autonomie professionnelle des directions.
Aucune décision stratégique ne devrait alors être automatisée sans validation humaine. Ensuite, les algorithmes doivent être transparents, interprétables et exempts de biais discriminants. Les données éducatives traitées par l’IA concernent des élèves, des enseignants, des communautés et exigent à ce titre une vigilance éthique (Selwyn, 2019).
Enfin, l’efficacité réelle de l’IA dépendra de sa capacité à s’inscrire dans une culture organisationnelle ouverte à l’expérimentation, au dialogue et à la formation continue.
L’IA ne sera jamais une solution magique; elle ne remplace ni la qualité du leadership, ni la force du collectif professionnel, ni l’expérience accumulée sur le terrain. Mais bien pensée, elle pourrait devenir un allié discret, mais puissant, en soutenant la lisibilité des situations complexes, en allégeant certaines tâches techniques et en ouvrant de nouveaux espaces de réflexivité.
Il est essentiel de concevoir l’intelligence artificielle et l’humain comme une équipe collaborative qui permet une répartition efficace des rôles où l’IA traite les aspects analytiques, tandis que les humains se concentrent sur les interactions et l’interprétation des résultats (Huang et al., 2019).
Dans cette dynamique, la direction d’école peut consacrer davantage de temps à l’exercice de son leadership pédagogique et à un accompagnement de proximité dans la gestion du projet éducatif. Il convient donc de considérer l’IA non comme une finalité technologique, mais comme un outil de prolongement outillé de la capacité humaine à piloter avec rigueur, éthique et intelligence contextualisée.
La gestion du projet éducatif en milieu scolaire québécois apparaît comme une activité à la fois complexe, évolutive et marquée par une diversité de tensions. Les situations typiques présentées dans cet article illustrent la complexité du travail de direction, constitué d’ajustements constants, de négociations implicites et d’un maintien d’équilibre fragile entre des logiques parfois contradictoires.
Dans ce paysage, l’intelligence artificielle offre des perspectives nouvelles. Loin de prétendre qu’elle soit en mesure de remplacer l’intelligence humaine, elle peut toutefois soutenir, enrichir et structurer le processus décisionnel. En facilitant la collecte et l’analyse des données, en allégeant certaines tâches techniques, ou encore en appuyant la régulation continue, l’IA peut contribuer à renforcer la capacité de pilotage stratégique des directions.
Cette intégration appelle une vigilance collective en matière d’éthique, de transparence et de contextualisation. La décision récente du ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) de suspendre l’intégration des assistants virtuels fondés sur l’IA générative dans les centres de services scolaires met en lumière l’absence de balises claires et souligne la nécessité urgente d’un cadre éthique et réglementaire pour encadrer son usage en milieu éducatif. Pour que l’IA devienne un levier pertinent dans le champ éducatif, il faudra co-construire des cadres d’usage exigeants, fondés sur la complémentarité entre savoirs professionnels, technologies numériques et visées éducatives.
Ainsi, le projet éducatif, loin d’être un exercice formel ou figé, doit être compris comme un outil vivant de transformation collective. Son pilotage appelle à une intelligence humaine renforcée, non par la technologie, mais par l’alliance entre discernement professionnel, outils numériques adaptés et finalités éducatives partagées.
C’est à cette condition que l’intelligence artificielle pourra réellement contribuer à une administration scolaire plus efficace et mieux arrimée aux réalités des établissements. Encore faudra-t-il, toutefois, prendre en compte son empreinte numérique sur l’environnement afin d’en assurer une intégration véritablement responsable et durable.
*À propos des auteur·es
Judicaël Alladatin est professeur à l’Université de Montréal, spécialiste de la gouvernance et de la planification de l’éducation. Ses recherches portent sur le développement professionnel des directions d’établissement scolaire, la réussite scolaire, le pilotage stratégique des établissements d’enseignement, la mobilisation et l’utilisation des données à des fins de prise de décision ainsi que les usages du numérique et de l’IA en administration scolaire.
Bianka Bessette est directrice d’établissement scolaire et doctorante en administration de l’éducation à l’Université de Montréal. Elle détient plus de quinze années d’expérience en milieu scolaire. Elle s’intéresse à la performance des systèmes éducatifs et à l’arrimage entre le leadership pédagogique, la planification stratégique et les pratiques professionnelles afin de soutenir la réussite des élèves.
Références
Alladatin, J., et Gnanguenon, A. (2025). Considérations théoriques, démarche et technologie pour l’élaboration d’un modèle de tableau de bord équilibré à l’usage des directions scolaires au Québec. Colloque ADERAE, ACFAS 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.15764519
Alladatin, J., et Soumanou, I. (2024). Hétérogénéité des tâches des directions d’établissements d’enseignement secondaire au Bénin : préoccupations pour une direction scolaire au service de la réussite éducative. Éducation et francophonie, 52(2), 97–106. https://doi.org/10.7202/1115421ar
Al-Omari, A. A. (2024). The Impact of Artificial Intelligence on the School Management: a Study of Oppotunities and Challenges in Jordan.
Barrère, A. (2006). Sociologie des chefs d’établissement : Les managers de la République. Presses Universitaires de France.
Collerette, P., Pelletier, D. et Turcotte, G. (2013). Recueil de pratiques des directions d’écoles secondaires favorisant la réussite des élèves. Université du Québec en Outaouais.
Day, C., Gu, Q., et Sammons, P. (2020). The impact of leadership on student outcomes: How successful school leaders use transformational and instructional strategies to make a difference. Educational Administration Quarterly, 56(2), 221–258. https://doi.org/10.1177/0013161X19861372
Flandin, S., et Ria, L. (2014). Former à et par l’analyse de l’activité : un état de la recherche. Revue française de pédagogie, (187), 77–90. https://doi.org/10.4000/rfp.4452
Gouvernement du Québec. (2022). Le projet éducatif-Guide. Ministère de l’Éducation.
Gouvernement du Québec. (2022). Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)-Guide. Ministère de l’Éducation.
Harris, A., Jones, M., et Adams, D. (2021). Leading system change: Lessons from England. Educational Research for Policy and Practice, 20(2), 189–205. https://doi.org/10.1007/s10671-020-09292-2.
Huang, M.-H., Rust, R. et Maksimovic, V. (2019). The Feeling Economy: Managing in the Next Generation of Artificial Intelligence (AI). California Management Review, 61(4).
Kaplan, R. S., et Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard: Measures that drive performance. Harvard Business Review, 70(1), 71–79.
Langlois, L. et Lapointe, C. (2007). Ethical leadership in Canadian school organizations: Tensions and possibilities. Educational Management, Administration and Leadership, 35(2), 247-260.
Lapointe, C. & Langlois, L. (2004). Identité professionnelle et leadership en éducation : analyse de pratiques collectives distinctes. Éducation et francophonie, 32(2), 175–190. https://doi.org/10.7202/1079078ar
Leithwood, K., Harris, A., et Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership et Management, 40(1), 5–22. https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077.
Luckin, R. (2018). Machine learning and human intelligence: The future of education for the 21st century. UCL Institute of Education Press.
Mandinach, E. B., et Gummer, E. S. (2016). Data literacy for educators: Making it count in teacher preparation and practice. Teachers College Press.
Mayen, P. (2012). Des situations potentielles d’apprentissage dans l’évolution du travail d’enseignants. Travail et Apprentissages, 10(2), 144–160. https://doi.org/10.3917/ta.010.0144.
Perrenoud, P. (2004). Développer la pratique réflexive dans le métier d’enseignant : Professionnalisation et raison pédagogique. ESF éditeur.
Poizat, G., etSan Martin, J. (2020). Le programme de recherche « cours d’action » : repères historiques et conceptuels. Activités, 17(2). https://doi.org/10.4000/activites.5277.
Savard, D., Larouche, C. et Goyette, N. (2024). La gestion axée sur les résultats et les systèmes d’information : des outils de gestion à appliquer avec discernement. Dans Le PL23 et l’INEE : excellence ou standardisation en éducation ? Réserves et propositions d’universitaires (p. 59-63). https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4855983
Selwyn, N. (2019). Should robots replace teachers? AI and the future of education. Polity Press.
Spillane, J. P., Parise, L. M., et Sherer, J. Z. (2011). Organizational routines as coupling mechanisms: Policy, school administration, and the technical core. American Educational Research Journal, 48(3), 586–619. https://doi.org/10.3102/0002831210385102.
Spillane, J. P., Reiser, B. J., et Reimer, T. (2002). Policy implementation and cognition: Reframing and refocusing implementation research. Review of Educational Research, 72(3), 387–431. https://doi.org/10.3102/00346543072003387.
Tahiru, F. (2021). AI in Education: a Systematic Literature Review. Journal of Cases on Information Technology, 23(1).
Thériault, S., etTremblay, D.-G. (2022). L’appropriation des salles de pilotage vers une gestion intégrée de la performance : le cas du système de santé au Québec. Recherches qualitatives, 41(2), 71–95. https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2022-v41-n2-rechqual07368/1092821ar/
Yvon, F., Poirel, E., Rousselle, J., et Girouard, C. (2022). Explorer le leadership des directions d’établissement scolaire par l’analyse de l’activité en autoconfrontation croisée. Recherches qualitatives, 32(1), 81–106. https://doi.org/10.7202/1089682ar